« La Faille de Gregory Hoblit, par Francis Moury | Page d'accueil | L'heure de la fermeture dans les jardins d'Occident de Bruno de Cessole »
20/08/2008
Le monde que Mario Praz a vu

Crédits photographiques : Smiley N. Pool (AFP/Getty Images).
«Les vivants et surtout les vivants qui ne veulent rien avoir de commun avec les morts, les survivants, sont informes, inachevés, et ils prennent cela pour une supériorité, parce qu’ils affichent leur vie. Mais la vie sans forme est ignoble, stérile, cancéreuse, célinienne. Tout homme de cœur et d’esprit, hier comme aujourd’hui, ne peut songer à la flatter, à la servir dans cet état. Les alliés ne sont pas là. Ils sont là où les formes se tiennent, ne demandant qu’à se perpétuer et se renouveler, dans l’empire du temps où les morts les détiennent.»
Préface de Marc Fumaroli à Mario Praz, Le monde que j’ai vu (Julliard, 1988), p. VII.
La sulfureuse réputation de Mario Praz, encore évoquée tout récemment par le roman de Bruno de Cessole, L'heure de la fermeture dans les jardins d'Occident (La Différence) dont je termine la lecture, Mario Praz que des générations d'Italiens superstitieux surnommèrent le Professeur en se signant dès qu'ils l'apercevaient, s'explique sans doute moins par ses fréquentations supposées avec le diable que par ses vues tranchées.
Je ne sais si Renaud Camus, qui se veut grand voyageur, grand lecteur et apparemment réactionnaire endurci aux yeux de ces mêmes journaliers insignifiants, a lu le remarquable recueil de textes de Mario Praz intitulé Le monde que j'ai vu (Il mondo che ho visto, 1982) publié par Julliard en 1988 et, comme il fallait hélas s'y attendre, devenu introuvable. Laissons la plus fine exégète de Camus, Valérie Scigala bien évidemment, nous répondre si elle le souhaite, puisque, chez elle, c'est une passion que de répondre à celles et ceux qui évoquent Camus, tout en nous épargnant les interminables digressions vaguement universitaires et fort chargées de vapeurs d'alcool qui composent l'ordinaire insignifiant de son blog. Si Camus et Scigala, par la même occasion ne connaissent pas Praz, qu'ils se procurent de toute urgence ce livre qui nous offre de superbes croquis de voyage sertis d'une très fine érudition, sans toutefois qu'ils soient gâchés par d'innombrables considérations, comme les goûte le Maître du haut château de Plieux, aussi inutiles qu'impuissantes dans leur évidente et constante mauvaise humeur.
Car, davantage qu'un réactionnaire authentique, Renaud Camus est un indéfectible grincheux, un emmerdeur patenté, dont le très intéressant et pour le moins volumineux Journal compte pourtant davantage de notations, parfois truculentes, d'un quotidien somme toute parfaitement insignifiant voire ridicule que de réelles méditations sur le monde et la littérature tels qu'ils ne vont plus guère. Que Camus, donc, oublie quelque peu son immarcescible et altier pourtour de nombril, pourquoi pas en lisant le livre de Mario Praz, exemple parfait d'une vision du monde qui, restant parfaitement personnelle, irriguée par une culture impressionnante, ne se noie jamais dans le solipsisme, cette boue douceâtre du soi-mêmisme. Après tout, le solipsisme n'est-il pas le pire des maux de notre époque infatuée et noyée sous les livres, crevant, étouffée, par les textes qu'elle ne sait même plus comment archiver ? Un peu d'air venu des hautes montagnes ou des gouffres verts des océans. Par pitié, un peu de souffle ouvrant, comme dans 2666, les livres pendus à des cordes à linge ! Et peu, si peu de commentaires, nous en avons des bibliothèques entières et l'art du critique ne meurt-il pas le premier, ses textes saponifiés comiquement sur quelque étagère poussiéreuse, misérable petit tas de peine, la lèpre des langages seconds évoqués par Merleau-Ponty dévorant les consciences et les énergies recroquevillées ? Espaçons aussi, enfin, les exégèses comme Daudet demandait à Bernanos d'espacer les soutanes dans ses premiers romans et que reviennent en grâce les vertus méprisées et oubliées d'une connaissance intime, donc orale, d'une parole résonnant dans notre esprit et notre chair, des grands auteurs plutôt que l'affadissement universitaire, pseudo et para-universitaire !
Une parole au service de l'action, rêve des héros de Carlyle, rêve de celles et ceux pour qui la littérature fut tout et rien, puis rien, qui auraient bien évidemment ri jusqu'à s'en étouffer si on leur avait prédit que leurs descendants et commentateurs noirciraient des feuilles immatérielles... Une parole qui est action, pour nous arracher le même cri de dépit et de dégoût, devant la péroraison vide et le vent de la rhétorique, que celui que Carlo Michelstaedter adressa à son ami, Enrico Mreule, dans une lettre du 29 juin 1910 : «depuis lors, combien tu as agi ! comme tes paroles se sont faites action ! je me nourris en revanche encore de mots et j’en ai honte» (Carlo Michelstaedter, Épistolaire, éditions de l’Éclat, 1990, p. 188. L'auteur souligne).
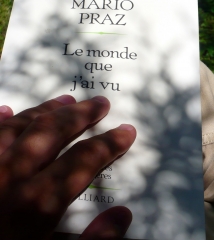 Sur l'ouvrage remarquable de Mario Praz, nul texte de présentation n'est vraiment nécessaire, pas même celui, pourtant excellent (l'art de la préface est un des plus difficiles, j'y reviendrais à propos de celle, stupide, du Sartor Resartus de Thomas Carlyle par un certain Maxime Berrée), de Marc Fumaroli, tant Mario Praz, par la limpidité de ses phrases, tapera sans la moindre béquille critique sur les têtes de bois universitaires et journalistiques.
Sur l'ouvrage remarquable de Mario Praz, nul texte de présentation n'est vraiment nécessaire, pas même celui, pourtant excellent (l'art de la préface est un des plus difficiles, j'y reviendrais à propos de celle, stupide, du Sartor Resartus de Thomas Carlyle par un certain Maxime Berrée), de Marc Fumaroli, tant Mario Praz, par la limpidité de ses phrases, tapera sans la moindre béquille critique sur les têtes de bois universitaires et journalistiques.En voici quelques morceaux (où sont précisés non seulement les pages de l'ouvrage en question mais le texte d'origine), présentés dans un ordre qui m'a paru significatif plutôt que logique.
[Voyage en Orient, 1956, p. 174]
«Lorsque je pense à la minutieuse préparation de ces explorateurs, à leur immersion préalable dans les classiques telle une retraite spirituelle, aux fatigues et aux dangers de leur voyage, à leurs longues étapes à une époque où la vie humaine était en moyenne plus brève qu’aujourd’hui, et que je considère d’autre part la rapidité presque inconsidérée de ma visite à la cité caravanière, plutôt que de tirer orgueil de notre civilisation qui permet d’aussi foudroyants passages, j’en viens à rougir de honte, comme si j’étais un iconoclaste qui parcourt négligemment des lieux «où les anges craignent de poser le pied».»
[Solitudes en Écosse, 1957, p. 292]
«Débarrassé des distractions créées par le fourmillement de la vie humaine qui nous entoure, notre esprit se dilate aux dimensions du paysage naturel, il s’étend et s’élève, il entrevoit des façons d’être qui transcendent la nôtre; ainsi le génie libéré d’une bouteille se dilate jusqu’aux confins du monde. La solitude est bien autre chose que ce que son nom nous suggère; au lieu d’être une aliénation du monde, elle est éveil au vrai sens du monde, elle est comme celui qui, une fois le silence établi autour de lui, entend finalement la musique qui n’avait cessé d’être là.»
[Absence de centre, 1960, pp. 141-2]
«Du reste toutes les grandes villes modernes, en raison même de leurs dimensions, sont centrifuges. Toute la civilisation moderne manque de centre, elle est, pour employer un mot particulièrement expressif, «décentrée» : les conséquences d’ordre esthétique et éthique sont aisément prévisibles.»
[Langue d’Oc, 1961, p. 312]
«Mais lorsqu’une ville ou un village n’est pas encore étouffé par cette fourmilière métallique et respire, lorsque ses odeurs terrestres ne sont pas encore noyées dans les exhalaisons d’essence, et que les bruits de la vie authentique ne sont pas encore submergés par le sombre bourdonnement mécanique, n’a-t-on pas l’impression de se sentir soulevé et d’évoluer dans un climat plus sain où les choses les plus simples acquièrent je ne sais quel raffinement, comme une peinture à la détrempe de la Renaissance débarrassée des huiles et des gras des retouches et des vernis dus aux pires restaurateurs du XIXe siècle ?»
[Goût australien, 1965, p. 272 et 275]
«Je dois avoir un esprit pervers si, à l’instar de Charles Lamb qui, allant visiter quelque célèbre country-house anglaise, s’enquérait tout d’abord du salon chinois, je suis attiré jusqu’en Australie par les vestiges du passé, acceptant tout ce qui est moderne comme a matter of course, comme allant de soi et qui ne réveille mon admiration que dans des cas exceptionnels, comme le nouveau musée ethnographique ou l’Université de Mexico.»
«Si l’Australie jusqu’à aujourd’hui n’a pas produit d’œuvres d’art d’une grande originalité, c’est parce que l’originalité (cela peut paraître paradoxal) est une fleur qui a besoin de l’humus d’une profonde tradition.»
[Montauto, 1966, p. 411]
«Comment, avec des éléments traditionnels, Piero della Francesca a-t-il pu composer ce Christ unique, voilà un problème de même nature que celui que nous pose le Lycidas de Milton, une élégie qui, tout en calquant des motifs traditionnels finit par devenir quelque chose d’unique. Il y a dans toutes les créations du génie un noyau irréductible dont aucune étude, fût-elle capillairement structurale, ne rendra jamais compte.»
[Russie traditionnelle, 1971, p. 371]
«À l’extérieur du portail de la cathédrale Saint-Isaac, à Leningrad également, une jeune touriste, le visage pâle comme celui d’un mort, était allongée par terre. Elle avait été frappée d’insolation (en vrai !) et attendait l’ambulance. Ainsi foudroyée, inconsciente, mais encore vivante, elle pouvait symboliser l’âme religieuse de la Russie dans l’attente d’un réveil.»


























































 Imprimer
Imprimer