« Actualité ou inactualité de Max Scheler, par Francis Moury | Page d'accueil | Anus mundi virtuel »
15/10/2005
De Roux le provocateur, Hallier l'imposteur

Crédits photographiques : Doug Van de Zande (Raleigh, North Carolina, Smithsonian.com).
«Nous devons être avec vous les initiateurs de quelque chose en formation. Constater tragiquement la littérature, c’est appeler la vengeance».
Lettre de Dominique de Roux à Raymond Abellio (9 juin 1966) citée par Jean-Luc Barré.
«S'il te semble, me lisant, être un peu figurant dans ta propre biographie, ne l'impute qu'au flou de ta pensée et à tes compromissions dans le siècle qui rendent difficile la libre parole».
Sarah Vajda
Notre longue discussion (dans un bar où, selon ses propres termes, on peut tout de même s'entendre) avec Pierre-Guillaume de Roux, a eu lieu finalement dans son bureau surchargé de livres et de manuscrits mais j'ai éte ému de revoir ce placide géant, ayant terminé, la veille, ma lecture de la superbe biographie (publiée par Fayard) que Jean-Luc Barré a consacrée à son père : le provocateur, l'intempestif, l'inactuel Dominique de Roux.
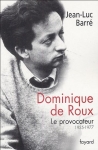 Outre les portraits subtils et émouvants consacrés par Barré à Robert Vallery-Radot (quel lecteur de Georges Bernanos a pu oublier le rôle que joua ce confesseur des âmes auprès du tragique romancier ?), Michel Bernanos dont les romans crépusculaires demeurent hélas méconnus et Ezra Pound qui comme tant d'autres furent fascinés par la frénésie prodigieuse de l'auteur de Maison jaune, cette très belle biographie est capitale quant à un aspect, à mon sens encore méconnu, de l'éditeur et écrivain : on y prend conscience de l'admirable, du fulgurant talent d'épistolier de Dominique de Roux. Un exemple, parmi une multitude réellement fascinante, de lettre, écrite à Robert Vallery-Radot, le 9 mars 1967 : «Il faut revenir à la Parole, à la simplicité évangélique de l’Écriture, et pour cela nous débarrasser de tant de vieux stocks de mots, de tant de livres, de tant de haines historiques récentes, repartir avec dans la valise les quelques livres choisis pour l’Ordre, pour recréer dans l’île déserte».
Outre les portraits subtils et émouvants consacrés par Barré à Robert Vallery-Radot (quel lecteur de Georges Bernanos a pu oublier le rôle que joua ce confesseur des âmes auprès du tragique romancier ?), Michel Bernanos dont les romans crépusculaires demeurent hélas méconnus et Ezra Pound qui comme tant d'autres furent fascinés par la frénésie prodigieuse de l'auteur de Maison jaune, cette très belle biographie est capitale quant à un aspect, à mon sens encore méconnu, de l'éditeur et écrivain : on y prend conscience de l'admirable, du fulgurant talent d'épistolier de Dominique de Roux. Un exemple, parmi une multitude réellement fascinante, de lettre, écrite à Robert Vallery-Radot, le 9 mars 1967 : «Il faut revenir à la Parole, à la simplicité évangélique de l’Écriture, et pour cela nous débarrasser de tant de vieux stocks de mots, de tant de livres, de tant de haines historiques récentes, repartir avec dans la valise les quelques livres choisis pour l’Ordre, pour recréer dans l’île déserte».De toute urgence, il faut que paraisse un recueil des lettres de Dominique de Roux pour rendre justice à son génie de l'ellipse ; j'ai été, sur ce point, rassuré, sans que je puisse pour le moment en dire davantage.
D'autres qualités sont à noter dans cette somme de Barré, par exemple la minutie de l'analyse consacrée par l'auteur à la période, dernière, touffue, riche en légendes et fantasmes de toutes espèces, que nous pourrions définir d'un terme barbare : esthético-politique. Non seulement le ralliement de Dominique de Roux à une sorte de gaullisme intemporel mais plus encore sa prescience d'une régénération définitive, messianique, qu'il croira dénicher dans les forêts de l'Afrique et au creux scintillant des vieilles légendes lusitaniennes.
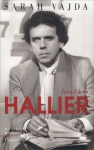 Comme, je le répète souvent, les hasards n'existent point, Sarah Vajda a fini par retrouver un exemplaire de sa propre biographie consacrée à Jean-Edern Hallier (parue chez Flammarion en 2003) qui on le sait connut longuement Dominique de Roux, avant, comme toujours, de se séparer de son ami. Je viens juste d'en commencer la lecture, à vrai dire passionnante. Un point tout de même, que je confirmerai ou infirmerai en cours de route : plus qu'une biographie, cet ouvrage prolixe, au style surchargé, bien souvent d'une fulgurance assassine, est un essai sur le mal français, sur le mal dont souffre l'écriture française depuis, au moins, plusieurs décennies. En quelques mots qui auront valeur de diagnostic : les écrivains n'écrivent plus mais parlent et, surtout, jouent à se vouloir écrivains, alors qu'ils ne sont que de pathétiques bavards...
Comme, je le répète souvent, les hasards n'existent point, Sarah Vajda a fini par retrouver un exemplaire de sa propre biographie consacrée à Jean-Edern Hallier (parue chez Flammarion en 2003) qui on le sait connut longuement Dominique de Roux, avant, comme toujours, de se séparer de son ami. Je viens juste d'en commencer la lecture, à vrai dire passionnante. Un point tout de même, que je confirmerai ou infirmerai en cours de route : plus qu'une biographie, cet ouvrage prolixe, au style surchargé, bien souvent d'une fulgurance assassine, est un essai sur le mal français, sur le mal dont souffre l'écriture française depuis, au moins, plusieurs décennies. En quelques mots qui auront valeur de diagnostic : les écrivains n'écrivent plus mais parlent et, surtout, jouent à se vouloir écrivains, alors qu'ils ne sont que de pathétiques bavards...En fait, cette biographie corrosive, en s'attaquant au simulacre bavard que fut Hallier, a dénoncé et fait éclater, avec courage et, surtout, je l'ai dit, un style éclatant auquel nous ne sommes hélas plus habitués, la baudruche du petit monde parisien des arts et lettres, gonflée à l'hélium sollersien, qui par tous les moyens tenta de s'engouffrer dans le siphon halliéresque. Comme je comprends que ce livre de feu ait dérangé les imbéciles, qui ont dû paraître tout penauds de se voir dépouillés de leur masque et, d'abord, la petite cohorte des fous d'Hallier !... Ainsi, sur l'ouvrage de Charles Ficat, Stations, dont l'un des trois textes chante le génie halliéresque, Sarah Vajda rappelle qu'il «omet simplement de se souvenir du poids d'or [qu'Hallier] tentait de recevoir en échange, des intermédiaires qui vendaient les dessins qu'il signait et des à-valoir reçus pour des livres-fœtus, comme des voyages offerts pour des reportages jamais rendus, servant de décor à des romans à demi écrit» (278). Déjà, en lisant ces quelques lignes, on imagine le danger réel qui guette notre pauvre biographe. Mais, bien vite, son cas va devenir réellement désespéré, l'auteur risquant cette fois un lynchage en règle pour avoir osé certaines de ses attaques. Ainsi, ce qui semblera aux imbéciles parfaitement impardonnable est le crime de lèse-majesté que commet Sarah Vajda en critiquant la bouffonnerie triomphante, généralisée : «Ce fut un siècle où Hallier ne faisait pas rire en se comparant à Homère, à Tacite ou à Tite-Live, un siècle où un journal à scandale, où fleurissait l'insulte, se réclamait de Karl Kraus pour qui l'injure privée relevait de l'idéologie petite-bourgeoise et devait, pour cela, être bannie» (280). Car écrire sur Hallier c'est sonder le ventre pourri de la France : «Si tu n'as pas écrit l'histoire du XXe siècle comme tu te plaisais à le rêver, tu en as si bien épousé les courbes que, désormais, vos visages se superposent, comme il m'a plu d'assembler les lignes de ta vie jusqu'à dessiner un portulan de France» (402).
Dès lors, Sarah Vajda semblera une déicide en puissance en reniflant la pourriture française, imputant, au passage, la rapidité de la contamination à quelques agents insignes, hérités d'une période trouble : «Que le régime de Vichy, héritier en bien des points de la IIIe République, ait fort mal obéi aux lois de l'hospitalité dans un pays où l'immigration ne représente guère une des constantes du génie national, n'indique pas qu'elle doive s'étendre aux citoyens qui, à leur tour, en useraient fort mal et que le loup une fois dans la bergerie, il faille laisser impunis les crimes commis par les victimes proches et lointaines du colonialisme et de l'esclavage. Ce grand désordre de la pensée française s'enracine dans la dangereuse culpabilité vichyste de l'après-guerre. Sollers, plus encore qu'Hallier contribuera à fortifier le méchant mythe des deux France où se font face, en un éternel combat, une France-fée née de l'affaire Dreyfus, entrée, presque unanime, en résistance et son double noir, sorcière nationale, entrée, massive, en collaboration» (132). L'attaque est rude mais ne faut-il point crier au scandale lorsque l'on lit la suite et qu'en un éclair nous comprenons que Sarah Vadja paraît déterminée à enfoncer la dague jusqu'au plus profond de la blessure française ? : «Hélas pour nos Jivaros, quelques esprits chagrins ont travaillé à l'anéantissement de ce mensonge que les manuels scolaires débitent à l'envi, mensonge vivifié dans les années 1980-1990, chargé d'exorciser le pays maudit. Quiconque refuse cette version se voit qualifié d'ennemi du genre humain : ennemi de cette belle France née casquée, armée, sous son nimbe de Lumières, à l'instant précis où Camille Desmoulins arrachait une feuille de platane dans les jardins du Palais-Royal et inventait ce qui deviendra la cocarde tricolore, qu'aucun sang pur ne saurait ternir. Aux armes bon docteur Guillotin ! A ce conte fameux, les gauchistes français, en dépit de leurs flirts avec le PC et de leurs trahisons successives, apporteront leur caution. Tout ce qui ne fleure pas bon la gauche pour Philippe Sollers s'avoue résurrection de Vichy, cadavre puant sorti des placards nationaux. Vichy-fiction, toujours. La question juive a servi d'écran au pays pour éviter de poser sur la balance le poids des idéologies, des folies et des passions françaises» (133). Jubilatoire ! Férocité implacable de la vérité, que le biographe ne peut que malaisément étayer (mais la vérité a-t-elle besoin de démonstrations pesantes ?) si ce n'est en exposant une intuition terrible : «[...] le nazisme n'a montré un visage humain aux Français travaillant en Allemagne, que parce que les juifs avaient, à l'avance, servi de monnaie d'échange» (404). Car, les derniers chapitres de la biographie, boursouflés et fiévreux, en témoignent, la question juive, à laquelle Hallier parut ne strictement rien comprendre que de grossier et de parodique, est le centre secret du livre de Sarah Vajda, le trou noir dévorant toute écriture : en tombant dans le vortex, les hautes paroles rayonnent une dernière fois et les mauvaises, les fausses (singulièrement donc, celles d'Hallier) se contentent, ma foi, de chuter sans gloire.
Entre ces deux ouvrages irremplaçables, de nombreuses passerelles, de nombreux passages. Aucun, je crois, sauf peut-être, l'évocation d'Abellio, commune aux deux auteurs, n'est plus attirant et secret que le portrait d'Ezra Pound, un de mes actes de lecture manqué lorsque, en hypokhâgne je crois, je commençais à lire les Cantos dans une édition de poche, le regard dubitatif, soupçonneux de mon professeur de français ajoutant à mon embarras face à une prose aussi complexe, essentielle, hermétique bien souvent.
Résumons-nous : la fine biographie écrite par Jean-Luc Barré m'a donné envie de lire ou de relire Dominique de Roux, celle de Sarah Vajda m'a dissuadé de lire les bizarres ouvrages de celui, Hallier, qui se rêva grand écrivain et ne fut que pitre surnuméraire, leur préférant et de loin les propres livres de Sarah, comme cette biographie de Barrès que je vais lire de toute urgence. C'est que Barré est un ouvrier honnête (je tiens ce qualificatif pour un compliment) et Vajda, dans la démesure et, parfois, la confusion de son écriture, un véritable écrivain qui eût dû, pour maîtriser le flot torrentiel, confronter sa propre maîtrise littéraire aux fulgurantes sécheresses d'un Dominique de Roux. Hallier, en somme, ressemble trop à son biographe si je puis dire et, par avance, en incarne les démons contradictoires.
Pour finir, ces deux livres me conduisent, de nouveau, devant les figures solitaires et terriblement silencieuses, injustement tues et effacées, de Pound et d'Abellio.
Parfois, comme par miracle, un siècle tout entier est sauvé de l'insignifiance par quelques brefs éclats d'amitiés remarquables.


























































 Imprimer
Imprimer