« Chris Foss ou l'éveil insoupçonnable | Page d'accueil | Circularité spéculaire de l'écriture »
28/01/2005
L'Aventure dans le plat pays de Flatland
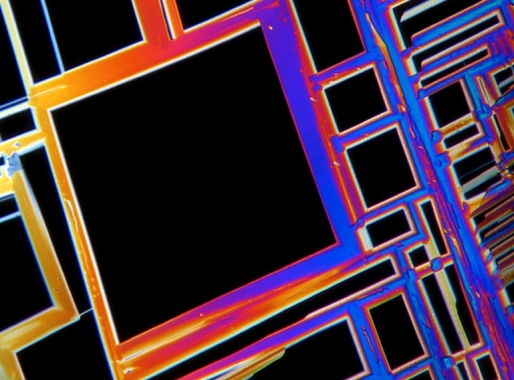
Crédits photographiques : Courtesy of Nikon Small World.
«Lait noir de l'aube nous le buvons le soir
le buvons à midi et le matin nous le buvons la nuit
nous buvons et buvons
nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré.»
Paul Celan, Fugue de mort
La polémique déclenchée jadis par les propos d'Hannah Arendt sur la banalité du Mal, celle, inepte et bien évidemment journalistique, ayant lamentablement accueilli la récente adaptation cinématographique des dernières heures d'Hitler reçoivent pourtant, chaque minute, une confirmation par l'évidence qu'il ne nous appartient même plus de contester. Enfer moderne, donc plat et refusant la moindre transcendance, fût-elle négative, enfer ridicule, ouinien, banalisé à l'extrême, sponsorisé même, mais oui, par la plus crasse vulgarité commerçante. De combien de gosses cet ogre s'est-il repu ? Il continuera à dévorer, n'en doutons pas car le Moloch est insatiable. La gamine qui sur ce blog (depuis fermé), exprimait sa douleur dans un langage à peine articulé se serait, selon Le Monde, jetée du haut d'une falaise avec une amie. Au rebours du misérable discours psycho-sociologique qui légitime aujourd'hui n'importe quelle révolte, y compris les moins admissibles, je me demande pourtant si ce n'est pas, finalement, l'incapacité de trouver un langage autre qu'estropié, pitoyable mais fun, défait pour dire le Mal et le désespoir, qui accélère la chute de ces pauvres dans l'abîme incolore. Attendons aussi, car il faut toujours que le sordide paraphe l'abject, attendons le message suintant de fausse tristesse et de componction miséreuse que ne manqueront pas de rédiger les patrons de Skyblog.
Alors que l’avenir éditorial de l’écrivain semble de nouveau incertain, il faut défendre Dantec car, quoi que l’on pense des défauts de ses textes (je n’ai jamais été, faut-il le rappeler, un lecteur permissif), de ses outrances verbales ou de ses positions politiques, il faut tout de même ouvrir les yeux et admettre cette évidence : Dantec est l’un des rares (je reste mesuré) écrivains français qui tente de penser la sortie de l’Occident hors du nihilisme (annoncé par Nietzsche, avec quel éclat prophétique ! et maintes fois génialement analysé par Heidegger) dans lequel il a sombré, malgré les beaux discours de nos dirigeants et de certaines de nos admirables consciences morales qui nous assurent que notre avenir, quoique sombre, finira par voir le triomphe du Bien sous les dehors du Progrès de la Civilisation.
Dantec est, à sa façon, un aventurier du Verbe. Je ne voudrais pas que l’on considère cette phrase comme une vulgaire accroche journalistique tentant comme il se doit de faire saliver les fans de l’écrivain en leur distillant quelques maigres informations habillées d’une fumeuse ambiance néo-gothique. Il y a des professionnels du cirque pour distraire les foules en délire et je crois qu’elles s’amusent suffisamment dans notre belle République depuis maintenant plusieurs dizaines d’années. Répétons donc que Dantec n’est pas une sorte de Gourou halluciné mais un écrivain, ce qui est à la fois une espèce bien plus commune et pourtant d’une tout autre épaisseur existentielle.
Je suis pour ma part l’homme le plus sérieux du monde toutes les fois que j’évoque l’œuvre de Dantec qui, en ces jours de commémoration faisant verser aux animalcules libérés (de quoi ? Pas de leur maigreur intellectuelle et de leur antisémitisme viscéral…) quelques fausses larmes de compassion, tente, à sa façon, de fouiller l’insondable gouffre dans lequel la parole est tombée.
Car la parole, je reste volontairement flou, a chuté, n’en doutons pas. Car l’écriture de Dantec, qui n’a bien évidemment pas connu dans sa propre chair l’horreur des camps à la différence d’un Primo Levi, d’un Jean Améry ou d’un Imre Kertész, est elle aussi pourtant née d’Auschwitz, est elle aussi hantée par l’horreur, ne craint pas elle aussi de tenter la descente aux Enfers, sans être bien certaine d’escalader ensuite quelque montagne auréolée de lumière. En lisant ces lignes, les imbéciles (y compris parmi les mauvais lecteurs de Dantec, il y en a bien sûr…) riront sans doute aux éclats. Peu importe, ces rieurs sont probablement ceux-là mêmes qui estiment que l’écriture n’a pas à se soucier de pareil gouffre dévorant alors que, quelle que soit la parade d’insouciance exécutée par ces paons, rien à faire, le langage tombe dans le puits en dégageant de formidables quantités d’énergie, qui seules peut-être empêchent que l’univers ne s’effondre puis se dissipe en une pulvérulente néance (je dis biens : néance, à la fois néant et béance).
Encore faut-il savoir lire, et (donc) écouter. Alors que, comme les myriades d’étoiles composant notre galaxie gravitent autour d’un immense vortex, toute parole qui se risque, délivre, avant de sombrer à son tour dans le gouffre, la clarté d’un éveil. Assurément, la parole de Dantec est de celles qui se risquent et risque beaucoup et, en risquant son salut, nous éveille et éclaire. Que cette clarté soit douloureuse n’est finalement qu’une caractéristique de sa nature.
Je parlai plus haut d’aventure. Voici un court texte de Laurent Schang intitulé Métaphysique de l’aventurier, ayant paru une première fois en 2002, dans le numéro 5 de la revue Cancer !. Disons qu’il s’agit, malgré sa feinte légèreté et l’air frais qu’il fait souffler dans les dédales obscurcis de la Zone, d’un entracte avant que nous abordions de front le dialogue entre Paul Celan et Martin Heidegger. Âmes légères, cœurs enrobés de sucre et esprits pétris de moraline seront priés de passer leur chemin.
 Un jour que Pierre Lazareff demandait à son ami Blaise Cendrars, «Blaise, avoue que tu n’es jamais monté dans le Transsibérien», il s’entendit répondre par l’intéressé, goguenard : «Si c’était le cas, ça changerait quoi, puisque je vous l’ai fait prendre à tous.» (1)
Un jour que Pierre Lazareff demandait à son ami Blaise Cendrars, «Blaise, avoue que tu n’es jamais monté dans le Transsibérien», il s’entendit répondre par l’intéressé, goguenard : «Si c’était le cas, ça changerait quoi, puisque je vous l’ai fait prendre à tous.» (1)Nul doute que l’aventure reste aujourd’hui encore un genre déconsidéré, mineur au sein de la grande famille littéraire. Manque de noblesse, d’élégance pour les uns, style approximatif pour les autres, tous les avis s’accordent sur la légèreté métaphysique du registre. Qu’il suffise pour s’en convaincre d’observer avec quelle difficulté Saint-Exupéry («le pilote aux mains pleines de cambouis») fut introduit dans les cénacles littéraires parisiens au titre rudement arraché d’écrivain, et non pas seulement à celui de curiosité pittoresque. Comme si l’action directe des personnages nuisait à l’action psychologique des romans. Pourtant, qui ne se souvient des longues heures solitaires passées à dévorer les pages d’un bon vieux London, Kessel, Kipling ou Fenimore Cooper, dont tout l’art consistait à nous transporter des milliers de kilomètres plus loin, des siècles plus tôt, dans un univers hostile, peuplé de rude gaillards plus ou moins (souvent moins) honnêtes, avec le même objectif en ligne de mire : dévoiler au lecteur émerveillé toute la richesse du monde et de la vie. Pierre Mac Orlan, à qui on ne la faisait pas dans ce domaine, écrivait sans rougir, en préface de Herman Melville : «La plus belle aventure du monde, c’est la vie» (2), ajoutant, à l’adresse de tous les poètes tuberculeux refaisant le monde du fond de leur chambre de bonne trop chauffée, que «la littérature lyrique n’a d’autre intérêt que de créer des soupapes de sécurité qui permettent à la vie mortuaire de ne point trop commettre de dégâts». Le genre aventureux comme thérapie à une société moribonde ? Examinons plutôt quelques cas d’écrivains qui ont osé «se salir les mains» («suer le burnous» aurait dit d’un gros rire caverneux un ancien de la Coloniale) en compagnie de ses héros/hérauts de la flibuste et du beau geste.
Le choix de l’aventure comme mode d’existence, par définition précaire, implique dans un double paradoxe une distanciation, de soi d’abord, puis des autres. L’aventure se vit pour elle-même, maîtresse jalouse de ses prérogatives, et par un aventurier en définitive soumis à ses caprices. A «l’art pour l’art» de Théophile Gautier répond l’adage «l’aventure c’est l’aventure» cher aux marins des sept mers ; aussi le mariage de l’art et de l’aventure nourrit-il ses pages de cette détonante philosophie de la gratuité de l’acte, du don vain.
Dominique de Roux a su mieux que quiconque retranscrire l’état d’esprit qui anime tant le débroussailleur de pistes que le prosateur – entendu que la littérature pleinement vécue comme acte de vie représente aussi une forme d’aventure : «Ces dernières années, j’ai compris ceci : la littérature et l’action révolutionnaire directe sont, toutes les deux, des modalités d’approche de la mort […]. C’est à travers la mort que la littérature devient action révolutionnaire, et c’est par la mort que l’action révolutionnaire rejoint la littérature.» (3)
L’aventurier, être d’exception, anomalie en ce monde, n’a pas sa place parmi les sédentaires, la cause est entendue. Lui seul dans l’apparent désordre de la société des hommes sait discerner l’ordre profond duquel il tirera sa raison de vivre. L’aventurier se construit au fil des routes, à force de coups de poings reçus et donnés et, à l’instar de l’écrivain penché sur ses cahiers raturés comme sur autant de miroirs, il se révèle dans ses actes. «Ce qui intéresse mon personnage central (plutôt que mon héros), c’est d’utiliser l’histoire pour se révéler à lui-même […]. Ce qui m’intéresse ce sont les individualités qui prenant prétexte des circonstances historiques données ont prétendu les façonner en utilisant les autres.» (4)
L’aventurier est un existentialiste. Peu importe en vérité la cause – l’objet dirons-nous – qui mobilise ses énergies, l’aventurier est un être désintéressé, que ne domine aucun des sentiments «réguliers» du vulgus commun. Dans Le coup de grâce, Eric von Lhomond résume ce détachement inhérent : «De plus, et quels que soient les dangers auxquels il a choisi de faire face, un aventurier (et c’est ce que je suis devenu) éprouve souvent une espèce d’incapacité à s’engager à fond dans la haine. Je généralise peut-être ce cas tout personnel d’impuissance : de tous les hommes que je connais, je suis le moins fait pour chercher des excitants idéologiques aux sentiments de rancune ou d’amour que peuvent m’inspirer mes semblables ; et je n’ai consenti que pour des causes auxquelles je n’ai pas cru.» (5)
S’il fait de l’exceptionnel son quotidien, l’aventurier vit son périple à la manière d’un ascète. Nul jouisseur ne saurait être un aventurier digne de ce nom (même considération quant à l’écrivain), l’appel de la jouissance menant inexorablement au consumérisme et à ses corollaires immédiats : l’intégration sociale, l’installation, l’embourgeoisement. «Il est difficile, note Mac Orlan, repris dans Les compagnons de l’aventure, d’écrire un roman d’aventures avec les exploits d’un sous-chef de bureau dans un ministère, mais Jack London, Conrad et d’autres peuvent assez bien réaliser ce roman avec leurs propres expériences. Ces écrivains appartiennent d’ailleurs à ce genre infiniment rare et précieux […] [ainsi] Alexandre Dumas, qui fut souvent plus près de la vérité humaine que beaucoup d’historiens trop dépourvus d’imagination.» Rien ne contente davantage l’aventurier que de vivre sur la brèche, constamment en équilibre instable. Du dépouillement il attend l’illumination quasi-mystique qui saura donner un sens aux choses, et répondre au pourquoi de sa condition même d’aventurier. A cette quête effrénée tout est bon : cruauté, violence, soûlerie. De ce feu qui le consume naît l’ambiguïté de son caractère toujours inquiet, ses brusques sautes d’humeur.
Vouant sa vie à ce Graal – a-t-on jamais vu un aventurier se signer avant de décharger son revolver ? – il arrive que l’aventurier s'abîme dans le nihilisme. C’est le cas, des plus troublants, de T.E. Lawrence, qui se brûla les yeux au contact de son rêve trop grand. S’exprimant à son sujet, Jean-Jacques Langendorf fait dire à son aventurier d’espion nazi : «Le cas de Lawrence est moins simple […]. Ce n’est pas son action, […] qui me paraît susciter cette grande satisfaction, mais les raisons mêmes pour lesquelles il l’exerce. Sa recherche est celle de l'évidence […]. Mais voilà la contradiction : l’aventure qu’il tente rend impossible la réalisation de ces trois conditions [pureté, solitude, domination de soi]. La saleté est partout. Comment trouver la pureté au milieu des trains qui explosent, des grappes de blessés qui basculent dans les précipices, des villages à demi brûlés, aux femmes violées et mutilées ? […] L’évidence s’efface, emportée comme une dune par le khamsin.» (6)
Ironique, Mac Orlan ne dit pas autre chose dans son indispensable bréviaire, le Petit manuel du parfait aventurier (7), qui, foin de dichotomie oiseuse sur l’aventurier actif et l’aventurier passif, dépendants l’un de l’autre comme l’est le lecteur de l’écrivain et l’écrivain du lecteur, décoche quelques vérités fort judicieuses sur le profil de l’aventurier : «Les voyages, comme la guerre, ne valent rien à être pratiqués […] car les détails fastidieux finissent par submerger la beauté véritable de l’action.»
L’action, l’action par et pour elle-même, est à la fois centre et finalité de la vie de l’aventurier, qui agit pour exister disions-nous, et ne conçoit sa réalisation qu’individuellement, libéré de toute contrainte sociale et matérielle. Seul est Corto Maltese (8), seuls aussi les personnages de Saint-Ex, Malraux et Hemingway, malgré tout. «Les amants sont toujours faibles et ridicules ; un livre d’amour, s’il n’est sensuel, ne peut que diminuer la valeur combative d’un homme et le respect que le lecteur doit toujours – ne fût-ce qu’un peu – au héros du roman qu’il lit.» (9) Ainsi rendu à lui, l’aventurier peut enfin déployer toutes ses qualités d’intrépidité, de courage, de débrouillardise. Des qualités contestées en raison de leur absence de contrainte, notamment par l’inattendu Jean-Paul Sartre, remarquable préfacier du non moins remarquable ouvrage de Roger Stéphane, Portrait de l’aventurier (10), pour qui l’homme d’action, terme qu’il emploie de préférence à celui d’aventurier, est un être nocif, parasite des mouvements révolutionnaires et de libération nationale, qu’il ne phagocyte que provisoirement et à son bénéfice exclusif, dans une frénésie d’autodestruction qui en fait bien, toujours selon Sartre, le fils exemplaire de le civilisation bourgeoise : «Il est frappant que Lawrence et Malraux soient des étrangers dans le pays où ils se battent. […] Entre la folle générosité et le suicide le plus égoïste l’action de l’aventurier oscille sans jamais s’arrêter. Elle réclame une foi et détruit toute foi. […] La fraternité, la camaraderie, l’amitié ? Oui, bien sûr. Mais cela signifie qu’il leur demande d’être les témoins de sa mort», poursuivant, propos d’un pessimisme de l’absurde qui n’engagent que leur auteur : «Le moment de la mort sera le sommet de leur vie, ils l’attendent ‘avec extase’ » Et de conclure : «L’aventurier avait tort : égoïsme, orgueil, mauvaise foi, il avait tous les vices de la classe bourgeoise.» (11)
A l’évidence, l’aventurier est un mauvais camarade. Comment le serait-il d’ailleurs, lui qui n’entrevoit la plénitude de son existence que dans son absolue liberté ? Mac Orlan toujours : «La condition de soldat qui est la mort collective ne peut guère être désirée par ceux qui ne conçoivent la mort violente que dans une sorte d’apothéose de leur personnalité et de la solitude sociale qu’elle finit par imposer […] pour l’orgueil de se sentir un être à part parmi les autres.»
Rebelle à toute autorité ou à la rigueur celle qu’il consent à suivre dans son propre intérêt, l’aventurier peut apparaître au non-initié comme une sorte d’anarchiste politique, ce qu’il est assurément. Loin de n’incarner qu’un cupide mercenariat, qui ferait du golden boy new-yorkais l’aventurier type de ce début de siècle (un comble !), l’aventurier est d’abord un être au sens plein, un «incroyant guidé» dont les valeurs aristocratiques, de volontarisme et de détachement mêlés, alimentent ses contradictions et, de là, sa richesse.
Dans Flèche d’Orient (12), Paul Morand relate la rencontre décisive de son héros, Dimitri, avec un capitaine de bateau roumain. Où Dimitri et Morand ne font qu’un : «Un lit de camp, un poêle, des appareils d’hydrographie, les cartes où le fleuve se lisait en bleu profond et les canaux en violet, un râtelier de fusils, des livres, des cordes roulées servant de descente de lit, il n’y avait rien d’autre dans la grande pièce peinte à la chaux. […]
Je l’envie, pensa Dimitri. Voilà un homme libre. Ce garçon doit avoir mon âge ; or, il a tout vu, il sait tout faire. Moi, je ne sais que dépenser de l’argent, vivre entouré de femmes et d’enfants…».
L’Aventure, celle avec un grand A, met en branle l’homme seul, libéré, «désaliéné», réalité insupportable pour la majorité, mais que lui, l’aventurier, revendique fièrement. En un sens, l’aventurier est le premier des humanistes, qui a pour lui la sincérité d’affirmer que par droits de l’homme il entend exercer les siens en priorité, contre ceux des autres si nécessaire. Questeur d’infini, s’il n’est en rien citoyen du monde, le monde est son labyrinthe initiatique au bout duquel (mais y a-t-il jamais une fin pour l’aventurier autre que la mort ?) se trouve la plus précieuse des pierres : lui-même. «Mieux encore, écrit Sartre, il prouve que […] l’homme existe parce qu’il est impossible.» Cette exigence métaphysique, l’écrivain la vit avec une pareille intensité, qu’il cherche à transmettre à son lecteur. Le roman d’aventure prend ici une épaisseur toute différente, sans commune mesure avec l’aspect de divertissement où on l’a trop longtemps confiné, une fonction contestatrice féconde, qui nous interroge sur le bien-fondé de notre civilisation «post-moderne».
Mac Orlan avait raison, qui déclarait que «les livres d’aventure sont dangereux.»
Notes
(1) Cité dans Christian Millau, Au galop des hussards (Éditions de Fallois, 1999).
(2) Pierre Mac Orlan, Les compagnons de l’aventure (Éditions du Rocher, 1997).
(3) Dominique de Roux, «Dernier entretien», Exil n°8-9, 1978.
(4) Jean-Jacques Langendorf, Un débat au Kurdistan (Éditions L’Age d’Homme, 2001).
(5) Marguerite Yourcenar, Le coup de grâce (Le Livre de Poche n°2001, 1996).
(6) J.-J. Langendorf, op. cit.
(7) Pierre Mac Orlan, Petit manuel du parfait aventurier (Mercure de France, 1998).
(8) Je recommande aux lecteurs le petit essai iconoclaste de Grégoire Prat, Corto Maltese et ses crimes (Hobay, 2005). Où l’on découvre que le pirate est coupable d’au moins soixante sept meurtres !
(9) Idem.
(10) Roger Stéphane, Portrait de l’aventurier (10/18, 1972).
(11) J.-P. Sartre, Ibid..
(12) Paul Morand, Flèche d’Orient (Gallimard, coll. Folio, 1999).


























































 Imprimer
Imprimer