« Mémoires d'un snobé de Marin de Viry | Page d'accueil | Ernesto Sábato, le dernier écrivain ? »
14/02/2012
Au-delà de l'effondrement, 39 : Terre brûlée de John Christopher

Crédits photographiques : Jérôme Prevost (Reuters).
 Tous les effondrements.
Tous les effondrements.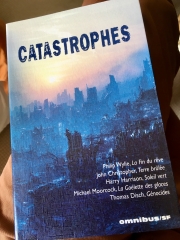 Paru en 1956 sous le titre original No Blade of Grass et traduit en 1975 par Alain Dorémieux pour les éditions Opta, le roman de John Christopher (1), de son vrai nom Samuel Youd, pourrait être lu comme le prologue de La route de Cormac McCarthy.
Paru en 1956 sous le titre original No Blade of Grass et traduit en 1975 par Alain Dorémieux pour les éditions Opta, le roman de John Christopher (1), de son vrai nom Samuel Youd, pourrait être lu comme le prologue de La route de Cormac McCarthy.Nous sommes d'abord frappés par l'économie des moyens qu'utilise Christopher pour évoquer, de façon tout à fait crédible, la brutale réapparition des réflexes premiers chez les hommes (cf. p. 332) devant l'ampleur de la catastrophe planétaire provoquée par la propagation rapide d'un virus baptisé le Chung-li (2) qui a pour propriété de détruire les plants de riz puis très vite, sous une de ses formes mutantes, de s'attaquer à l'ensemble des céréales.
Les verdoyantes prairies anglaises, puisque l'histoire se déroule, comme celle du Rat blanc de Christopher Priest en Angleterre, ont tôt fait de se transformer en étendues de terre pulvérulente sillonnée par des bandes plus ou moins animées d'intentions amicales.
Nous suivons le voyage, en voiture puis à pied, d'un groupe de Britanniques qui, informés des plans criminels du Gouvernement (raser au moyen de bombes atomiques les principales villes anglaises, afin que le pays puisse à peu près décemment nourrir les survivants), ont décidé de quitter Londres pour rejoindre une terre familiale, au Nord de l'île, qu'ils estiment être à l'abri des hordes de misérables qui ne vont pas tarder à parcourir les routes du pays à la recherche d'une nourriture de plus en plus rare.
Parcours semé d'embûches, de violence, de viols et même de meurtres, cortèges de malheurs prévisibles, n'en déplaise aux belles âmes, des mondes qui s'écroulent que nous pourrions résumer admirablement par cette phrase : «Quand l'estomac crie famine, il n'y a plus que sa loi qui compte !» (p. 223), et cela y compris pour les si policés sujets de Sa Gracieuse Majesté : «Ce sera un spectacle intéressant de nous voir tous, Britanniques jusqu'au bout des ongles et la bouche pincée, pendant que les nuages d'orage vont s'amasser. Inattaquables. Mais qu'arrivera-t-il quand nous craquerons ?» (p. 238).
Et, de fait, nos personnages ne craquent pas, surtout celui qui est désigné comme assumant le rôle de chef de la petite troupe, John Custance qui, bien vite, témoignera de l'insensibilité et de l'indifférence nécessaires (cf. p. 323) pour parvenir à rejoindre la terre de son frère David et formera, avec l'inquiétant et redoutable Pirrie (le personnage sans doute le mieux campé par Christopher, qu'on regrette presque de voir mourir à la fin du roman), un couple de combattants aguerris et, surtout, intraitables. Dans ce livre, sont à peine esquissés les contours d'une phénoménologie du charisme du chef devenu «figure de proue» (p. 375), cette autorité mystérieuse qui investit un être plutôt qu'un autre à la faveur d'un événement dont il a, seul, mesuré la profondeur sacrée : «Alf Parsons fut le premier à s'exécuter, mais les autres se mirent en file derrière lui. Plus que jamais, cela ressemblait à un rituel. Celui-ci, avec le temps, pourrait en venir jusqu'au genou ployé, mais même cette simple poignée de main représentait, de façon indiscutable, l'hommage du féal à son suzerain» (pp. 341-2). Les meilleurs romans décrivant la fin du monde fourmillent toujours de la description de ces minuscules attitudes humaines qui, demain peut-être, deviendront le substrat de cérémonies sacrées sinon religieuses.
Nombreuses sont les déclarations faites par l'auteur, peut-être simplistes, mais d'une simplicité qui est la condition première de la survie en temps de banqueroute (cf. p. 337), sur la nécessité, alors que toute loi a été abrogée, de revenir au système de la vengeance pure et simple (cf. p. 282), du châtiment expéditif pour la faute commise par celles et ceux qui, plus vite que des loups encagés redevenus libres, sont retournés à l'état de bêtes sauvages : «dans le passé, la justice a toujours été rendue dans les règles. Maintenant, le mot de justice lui-même ne veut plus rien dire, au milieu de ce champ où ce sont les armes qui parlent» (p. 284).
Cette simplicité s'explique selon John Christopher par l'urgence de la situation : John Custance n'est en aucun cas une brute et ne peut ainsi s'empêcher de penser à ceux qui, au moment même où il traverse les terres britanniques ravagées, «perpétuaient la tradition, qui continuaient à parler le langage de l'amour pendant que Babel se dressait autour d'eux» (p. 299) mais ces chimères ont désormais presque autant de poids que «les critères moraux» formant «une lignée remontant à près de quatre mille ans» et pourtant balayés «en un jour» (ibid.).
De façon assez poétique, John Christopher, bien davantage qu'une nostalgie du monde cassé, perdu, évoque les nouvelles légendes (3) qui finiront par donner un peu d'humanité au monde détruit par le virus : «L'imagination de John dérivait. Et si tout cela n'était qu'un mauvais rêve, dont ils allaient s'éveiller pour retrouver le monde ancien, ce monde de tous les jours qui déjà se mettait à avoir l’auréole magique de ce qui est irrémédiablement perdu ? Il y aurait des légendes, songea-t-il, qui parleraient de larges avenues entièrement illuminées, de millions d'individus vivant côte à côte sans penser à s'entretuer, de trains, d'avions et d'automobiles, de nourriture dans toute sa diversité. Et qui parleraient aussi des policiers : gardiens, dépourvus de colère et de malice, d'une loi s'étendant d'un bout à l'autre de la Terre» (p. 291).
Renaissance, après le déluge, des mythes fondateurs communs à toutes les cultures, comme celui d'un Âge d'Or.
Cette citation est loin de constituer un exemple unique, comme nous le voyons tout au long du roman : «Au fait, je réfléchissais à une chose : tu crois qu'il s'écoulera combien de temps avant que les voies ferrées cessent d'être identifiables ? Vingt ans ? Trente ans ? Et combien de temps les gens se rappelleront-ils qu'il existait autrefois des choses qu'on appelait les trains ? Est-ce que nous raconterons des contes de fées à nos arrière-petits-enfant en leur parlant de monstres de métal qui avalaient du charbon et vomissaient de la fumée ?» (p. 317).
La leçon du roman est cependant riche de son ambiguïté car, si, à la fin de leur périple, une poignée de personnages parvient (non sans avoir tué le frère de John, comme une moderne transposition de l'épisode de Caïn et Abel) à s'abriter dans la terre promise, Éden perdu reconquis de haute lutte, l'auteur prend le soin, à plusieurs reprises, d'affirmer que la survie n'est qu'une possibilité parmi d'autres, l'une d'entre elles constituant même le scénario le plus radical : «D'abord la Chine, ensuite le reste de l'Asie, maintenant l'Europe. Les autres parties du monde tomberaient à leur tour, même si elles restaient incrédules jusqu'à la fin. La nature effaçait avec un chiffon l'ardoise de l'histoire humaine, la laissant vierge pour les pathétiques gribouillages de ceux qui, en des points quelconques à la surface du globe, survivraient en petit nombre» (pp. 317-8).
Ambiguïté redoublée par le fait que, selon l'auteur, regagner ou gagner, et cela à n'importe quel prix, un havre de paix, une citadelle (4) qui a été perdue est l'unique rempart contre la sauvagerie. En somme, nous pourrions prétendre à bon titre que l'instauration d'une utopie est un événement qui ne peut s'encombrer de bons sentiments et nécessite une mise entre parenthèses, qu'on espérera la plus brève possible, des règles de conduite dans une société qui, de toute façon, s'est délitée en quelques jours à peine : «Ceux qui n'arriveront pas à trouver un terrain d'où on ne pourra pas les déloger, ceux-là finiront dans la sauvagerie... si seulement ils survivent» (p. 339).
Nous retrouvons ici la très antique idée selon laquelle la fondation d'une cité est la première pierre qui permet à l'homme de redresser la tête, et d'envisager une survie qui, au fil de siècles d'efforts et de souffrances, pourra même se transformer en vie digne d'être vécue.
La civilisation, en somme, n'est absolument pas un dû et, comme toute chose sur cette planète, sans doute même plus que n'importe quelle autre chose, doit être payée au prix fort.
Notes
(1) Ce roman peu connu a été recueilli dans l'excellent recueil intitulé Catastrophes publié par Omnibus (dans la collection SF) en 2005. Toutes les citations entre parenthèses renvoient à notre édition.
(2) «Les virus sont des trucs bizarres [...]. Ils sont comme des principautés ou des empires, à leur échelon. Ils conquièrent tout pendant un siècle ou pendant trois mois, et puis ils sont éliminés. Ce n'est pas souvent qu'on rencontre chez eux l'équivalent de Rome, avec une puissance qui s'étend sur un demi-millénaire» (pp. 244-5).
(3) «[...] ce serait là comme une sorte de légende du futur qu'on se raconterait au coin du feu, un rêve éveillé» (p. 317). Notons que c'est justement ce rêve éveillé qui permettra peut-être, selon John Christopher, de redonner une âme et un élan d'exploration aux survivants : «Une légende qui, peut-être un jour, finirait par pousser les nouveaux barbares à travers l'océan, pour trouver une terre aussi rude et brutale que la leur» (ibid.).
(4) «Vous ne voyez donc pas que la justice et les parts égales sont des notions périmées quand il s'agit de défendre une citadelle contre l'assaut des barbares ?» (p. 350).


























































 Imprimer
Imprimer