« Surréalisme et réalisme dans la trilogie autopunitive d’Alexandre Mathis, par Francis Moury | Page d'accueil | Dracula, 1 : Dracula de Tod Browning et George Melford, par Francis Moury »
26/02/2010
Brian Evenson, Michael Herr, Yannick Haenel au miroir de La Bruyère

Crédits photographiques : Fredy Builes (Reuters).
À propos de Contagion de Brian Evenson paru aux éditions Le cherche midi, 2009, Putain de mort de Michael Herr (Albin Michel, 2010) et Maximes et autres pensées remarquables des moralistes français de François Dufay (CNRS Éditions, 2009).
LRSP (livres reçus en service de presse, du moins pour les deux derniers).
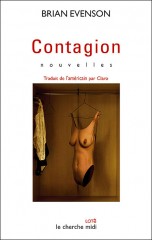 Le lecteur qui voudra lire de bons textes sur les ouvrages de Brian Evenson devra prendre connaissance des différents textes que lui ont consacré certaines plumes (dont celle de François Monti, la moins banale de ce disparate critique) du Fric-Frac Club. C'est le second ouvrage d'Evenson que je lis, après Inversion et, ma foi, je suis sorti de cette lecture un peu plus dubitatif encore à l'égard de cet écrivain qui, sur le papier, devrait pourtant me plaire : thèmes lancinants de la religion, du péché, du langage, du corps qui se corrompt, de l'esprit qui se brise et sombre dans la folie, Evenson ressemble à un mélange peu banal d'Hawthorne et de Lovecraft.
Le lecteur qui voudra lire de bons textes sur les ouvrages de Brian Evenson devra prendre connaissance des différents textes que lui ont consacré certaines plumes (dont celle de François Monti, la moins banale de ce disparate critique) du Fric-Frac Club. C'est le second ouvrage d'Evenson que je lis, après Inversion et, ma foi, je suis sorti de cette lecture un peu plus dubitatif encore à l'égard de cet écrivain qui, sur le papier, devrait pourtant me plaire : thèmes lancinants de la religion, du péché, du langage, du corps qui se corrompt, de l'esprit qui se brise et sombre dans la folie, Evenson ressemble à un mélange peu banal d'Hawthorne et de Lovecraft. La quatrième de couverture de Contagion évoque même les noms de Beckett et de Borges dont il serait l'héritier, on le suppose, digne. Peut-être. Dans son entretien avec l'auteur, Éric Bonnargent évoque Kafka, et Evenson, dans sa réponse, affirme qu'il aime les romans de Leonardo Sciascia, Cormac McCarthy, Friedrich Durrenmatt et Flannery O’Connor.
Comment se fait-il qu'avec de pareilles influences, avec ce sans faute (oublions les noms de Deleuze et surtout Derrida) concernant les figures tutélaires, les livres d'Evenson ne me fassent, au mieux, que bâiller ? Vais-je incriminer le travail de Christophe Claro, ce stakhanoviste de la traduction ? Pour ce que je puis en juger, celle-ci m'a l'air fidèle, à peu près autant que celle qu'il avait donnée du très ennuyeux Les Fusils de Vollmann.
Parcourant le texte anglais, me concentrant sur la nouvelle à mes yeux la plus intéressante de ce recueil, qui lui a d'ailleurs donné son titre, je constate que le problème réside dans l'écriture même d'Evenson, dont les cauchemars m'apparaissent brouillés, voulant sans doute trop signifier en dépit même de leur mutisme, leurs lacunes et ellipses. En fait, l'interprétation des textes du romancier semble d'autant plus ouverte qu'elle n'est qu'un leurre : je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire des livres d'Evenson, et que ce pas grand-chose suffit à faire s'extasier et hélas bavarder, beaucoup de personnes. Voyez ainsi la longue nouvelle qui s'intitule Le fils Watson : les gloses probables que ce texte fera germer évoqueront, une fois de plus, les figures tutélaires de Borges et Kafka, parleront de cauchemar rationnel, de fable religieuse, d'absurdité existentielle, de pur jeu formel, que sais-je encore ? Pourtant, qu'écrire réellement sur ce texte une fois lu ? Rien. C'est un cauchemar et ses milliers de trousseaux de clés ouvrent moins de portes interprétatives qu'elles ne referment, lourdement, quelques trappes sur la puissance évocatoire de la littérature.
De la prose, en somme, pour amateur de schizophrénie et d'autres mots qui comportent la racine schize, qui sauront donner un sens quelconque ou bien les sens les plus divers voire absolument contraires aux textes troués d'Evenson qui à mes yeux ne sont qu'obscurs, très faussement kafkaïens, même pas beckettiens.
Kafka justement. L'écrivain qui, par excellence, a favorisé, inspiré, littéralement nourri le travail de la critique, parfois même la prolifération d'études loufoques qui se sont déposées comme une gale sur un corps que l'on a désormais toutes les peines du monde à pouvoir contempler débarrassé de ses centaines de peaux exégétiques. D'où vient pourtant le fait que même les textes les plus étranges de cet écrivain me paraissent non point clairs (dans leur signification, qui peut me résister ou m'échapper) mais lumineux (dans leur intention), de la même façon que le sont les paraboles évangéliques, destinées à être comprises du plus grand nombre et se donnant, pourtant, dans leur énigme ? Kafka éblouit, sidère et cette suspension de notre jugement implique l'échec même de la clarté, des efforts de notre compréhension. Evenson, que l'on me pardonne de rapprocher de Kafka ce nom, n'éblouit ni ne sidère. De même, il ne me semble pas clair. Je vois dans cette opposition l'irrémédiable gouffre qui sépare le paradoxe véritable, lequel se nourrit d'une tension irrémédiable entre deux vérités inconciliables, du faux mystère, la vérité du kitsch, l'hermétisme de l'obscur. Celan, Trakl sont hermétiques, jamais (prudemment, disons : rarement) obscurs, au contraire de ce que Primo Levi affirmait.
Je ne connais point suffisamment les livres d'Evenson, et ceux que j'ai lus me semblent obscurs, pour m'aventurer à rédiger une critique développée de ces quelques points qui ne sont que des intuitions, que deux lectures ne font néanmoins que confirmer.
Inutile quoi qu'il en soit, du moins pour le moment, de poursuivre ma découverte de cet auteur qui incarne une bonne partie de ce que je n'ai jamais aimé en matière de littérature : l'innovation formelle ou stylistique, si chère aux amoureux des titres publiés par Le Cherche midi dans sa collection Lot 49. Hélas, j'ai presque toujours constaté que ce souci de la forme ou, pour le dire brièvement, de l'expérimentation typiquement avant-gardiste, a l'étrange vertu de se révéler périmé avant bien des ouvrages réputés classiques de forme et pourtant, allez donc savoir pourquoi, non seulement passionnants mais infiniment plus résistants aux modes littéraires que ces savants bouquins sans début ni fin, dont l'obscurité faisant bavarder les journalistes et leurs épigones n'est que le cache-misère d'une pauvreté flagrante de talent et de don. N'en déplaise, d'ailleurs, à Rémy de Gourmont, auteur de cette inhabituelle, sous sa plume, bêtise : «C’est singulier : en littérature, quand la forme n’est pas nouvelle, le fond ne l’est pas non plus» (in Des pas sur le sable, Rennes, éditions Ubacs, 1989).
Et puis, une raison toute pratique me retient de poursuivre ma lecture d'Evenson, que je laisse à ses mutilations, de textes et de corps : les bons romans reçus en service de presse sont légion sur les étagères de ma bibliothèque pléthorique.
 Putain de mort [Dispatches] de Michael Herr, qu'Albin Michel se décide enfin à rééditer trente années après sa première publication en langue française, est l'un de ces bons livres. Toute personne aimant les récits consacrés à la guerre du Vietnam sait que, parmi une rare poignée d'écrivains comme Tim O'Brien, Bao Ninh et Harold G. Moore, Michael Herr, qui a collaboré aux scénarios de deux des films les plus connus consacrés à ce conflit qui continue de hanter l'imaginaire nord-américain, Apocalypse Now et Full Metal Jacket, a donné avec son livre l'un des meilleurs témoignages sur les raisons peu avouables qui peuvent faire de la guerre non seulement un plaisir trouble (If war was hell and only hell and there were no other colors in the palate, [if] that was the essence of the experience and all that there was to the experience, I don't think people would continue to make war) mais aussi une véritable expérience intérieure, comme il l'affirme dans un magnifique documentaire de Coco Schrijber, First Kill, dont les références littéraires évidentes sont Heart of Darkness de Conrad et Lord of the Flies de Golding.
Putain de mort [Dispatches] de Michael Herr, qu'Albin Michel se décide enfin à rééditer trente années après sa première publication en langue française, est l'un de ces bons livres. Toute personne aimant les récits consacrés à la guerre du Vietnam sait que, parmi une rare poignée d'écrivains comme Tim O'Brien, Bao Ninh et Harold G. Moore, Michael Herr, qui a collaboré aux scénarios de deux des films les plus connus consacrés à ce conflit qui continue de hanter l'imaginaire nord-américain, Apocalypse Now et Full Metal Jacket, a donné avec son livre l'un des meilleurs témoignages sur les raisons peu avouables qui peuvent faire de la guerre non seulement un plaisir trouble (If war was hell and only hell and there were no other colors in the palate, [if] that was the essence of the experience and all that there was to the experience, I don't think people would continue to make war) mais aussi une véritable expérience intérieure, comme il l'affirme dans un magnifique documentaire de Coco Schrijber, First Kill, dont les références littéraires évidentes sont Heart of Darkness de Conrad et Lord of the Flies de Golding. Dans son livre halluciné qui n'hésite pas à privilégier plusieurs formes de narration sans jamais être obscur ni artificiel, le statut de Michael Herr, auteur qui s'inscrit parfaitement dans la vérité historique, quitte à balayer quelques contre-vérités sur le sens de l'engagement des Marines et celui de leurs chefs, est bien sûr celui d'un témoin direct des événements qu'il décrit. Collègues, chapitre dans lequel Herr évoque ses compagnons que furent les reporters de guerre qui, à la différence des simples appelés, s'engageaient dans cette guerre en toute connaissance de cause, évoque l'une des raisons de la véritable mission qu'accomplissaient ces journalistes qui, seuls sans doute, méritent de porter ce titre, comme
 les célèbres Dana Stone et Sean Flynn, disparus corps et biens dans la jungle (photo ci-contre) : le courage (l'un des derniers mots de ce beau livre, p. 264), la volonté de comprendre ce qui, dans un pays où la mort rôde derrière chaque arbre, a pu déclencher une telle spirale de violences. La compassion aussi qui, selon l'auteur, distinguait les meilleurs journalistes de la masse amorphe des imbéciles répétant ce que les officiels voulaient qu'ils répètent, y compris en utilisant l'affreux novlangue militaire : «des trucs comme «rafales minimum» (un jour, une de celles-ci a déchiqueté un grand-père et deux enfants alors qu'ils couraient le long d'une rizière [...], «pertes amies» (ni amicales, ni drôles), des «contacts de rencontre» (embuscades)» (cf. p. 228). Dans Putain de mort, je n'ai pas relevé, de la part de Herr, une volonté de délivrer une longue explication rationnelle (1) qui tenterait de dépasser la thématique, traditionnelle, de l'impossibilité de traduire les expériences de violence pure par les mots.
les célèbres Dana Stone et Sean Flynn, disparus corps et biens dans la jungle (photo ci-contre) : le courage (l'un des derniers mots de ce beau livre, p. 264), la volonté de comprendre ce qui, dans un pays où la mort rôde derrière chaque arbre, a pu déclencher une telle spirale de violences. La compassion aussi qui, selon l'auteur, distinguait les meilleurs journalistes de la masse amorphe des imbéciles répétant ce que les officiels voulaient qu'ils répètent, y compris en utilisant l'affreux novlangue militaire : «des trucs comme «rafales minimum» (un jour, une de celles-ci a déchiqueté un grand-père et deux enfants alors qu'ils couraient le long d'une rizière [...], «pertes amies» (ni amicales, ni drôles), des «contacts de rencontre» (embuscades)» (cf. p. 228). Dans Putain de mort, je n'ai pas relevé, de la part de Herr, une volonté de délivrer une longue explication rationnelle (1) qui tenterait de dépasser la thématique, traditionnelle, de l'impossibilité de traduire les expériences de violence pure par les mots. La mort est le véritable maître du Vietnam et tous les mensonges de la presse n'y changeront absolument rien (2) puisque cette dernière est parfaitement incapable de «restituer son sens à la mort, et naturellement il ne s'agissait pas d'autre chose» (pp. 220-1), comme l'écrit l'auteur qui, ailleurs (p. 260), en une seule phrase paradoxale extrait l'essence de toutes ces histoires de survie : le Vietnam est un «espace de mort» où l'on trouve une «forme de vie» et en comprendre la nature, c'est tenter de saisir ce moment initiatique «où on se baisse pour mordre la langue d'un cadavre» (p. 259).
Herr, hormis ces quelques notations (qui presque toutes proviennent des dernières pages de son livre) quant au sens du travail des journalistes plutôt que des médias dans leur généralité sur le théâtre des opérations, ne fait que décrire ou plutôt, au sens noble du mot, raconter ce qu'il a vu. Michael Herr est donc un témoin. Il a vu, il évoque par des mots ce qu'il a vu. Loin de toute la fade masturbation pseudo-littéraire de Yannick Haenel (lecteur de Giorgio Agamben) sur le sens et l'impossibilité du témoignage, Michael Herr, à l'américaine diraient les sots, fonce, décrit les cadavres, les paroles, les odeurs, les tactiques, les peurs, les courages, les mille et une anecdotes (3) qui constituent le tissu même d'une guerre. Certes, il y aurait quelque manque pour le moins flagrant de rigueur méthodologique à rapprocher Putain de mort de Jan Karski de Yannick Haenel : d'abord parce qu'il n'y a aucun souffle littéraire dans le faux livre de ce dernier, qui nous donne l'image la plus fidèle de ce que pourrait être le non-style absolu d'un ectoplasme qui, en guise d'expérience intérieure, n'aurait rien connu de plus terrible qu'un raout germanopratin. Putain de mort qui n'en est pas un, se lit pourtant comme un roman. Ensuite, Yannick Haenel, qui ne sait même pas correctement citer le grand Celan, n'a été le témoin de rien du tout, ce que nous ne saurions, bien évidemment, lui reprocher. Il ne s'agit point là d'une excuse cependant puisqu'un écrivain comme Cormac McCarthy a pu décrire, dans La Route, l'état d'extrême déréliction, comparable à la survie dans la zone grise évoquée par Primo Levi, auquel celui qui tente de survivre est confronté. Jusqu'à preuve du contraire, et quel que soit le souci que McCarthy, comme d'ailleurs Vollmann, accorde au fait, capital pour le texte, de coller le plus fidèlement possible à la réalité brute des faits, le grand romancier n'a point sillonné les routes nord-américaines avec son fils et un chariot de courses rempli de hardes pourries ! Michael Herr, enfin, n'a pas prétendu écrire un roman qui prendrait quelques libertés avec l'histoire. Il s'est borné à transformer en livre sa série d'enquêtes pour le magazines Esquire. Pourtant, Michael Herr, qui s'en tient à la stricte matérialité des faits et des dates, nous donne un véritable roman, le témoignage, d'abord, d'une écriture alors que Yannick Haenel, qui, au mieux, ne parvient qu'à paraphraser deux documents existants pour leur ajouter une partie purement fictionnelle au style absent plutôt que blanc, nous conduit à quelques milliers de lieues de la simple beauté et horreur des faits historiques. Il les aplatit. Il les pervertit. Il les gauchit. En ce sens, j'affirme que Yannick Haenel ne fait pas un travail d'écrivain mais de faussaire, et de faussaire pas même capable de s'approcher de son modèle. Échouant à nous donner un livre qui fût au moins habile voire retors, Yannick Haenel, récompensé par un prix qui devrait être décerné aux anciens journalistes seulement, n'est même pas cela : un simple journaliste. Un écrivain, quel que soit le matériau qui a constitué le tuf de ses livres, quelles que soient les années qu'il a consacrées, comme Flaubert ou Bloy, à se documenter sur un sujet, donne à la réalité, une fois que son génie l'embrasse, une tenue plus haute que celle d'une paraphrase ressassant la petite complainte du nihilisme soi-disant fustigé par les cacographes de Ligne de risque. Yannick Haenel, qui n'est pas un écrivain, qui n'est même pas un journaliste de talent mais la chimère hâtive et contrefaite résultant des expériences réalisées par le Docteur Moreau-Sollers, non seulement aplanit la réalité mais déguise la vérité, alors que le grand roman est celui qui, de la vérité, donne une image dont la vérité artistique est bouleversante évidence. Parmi des centaines d'exemples possibles, l'un des plus grands romans méconnus de William Faulkner, Parabole, s'insère strictement dans le cadre bien connu du Premier conflit mondial pour, dès la première page, en faire éclater les limites qui se révéleraient trop purement contingentes : protagonistes, pays en guerre, tactiques des combats, dates figurant dans les livres d'histoire, etc. Le livre de Yannick Haenel, je répète cette évidence, n'est donc pas un roman, premier mensonge écrit pourtant sur la couverture. Son livre n'est même pas un ouvrage mêlant habilement fiction et vérité historique, second mensonge. Son livre n'est même pas la paraphrase à peine déguisée d'autres textes. Le livre de Yannick Haenel n'est que la simple juxtaposition de rédactions poussives et transparentes de fausse humilité qu'un élève si l'on y tient un peu doué d'hypokhâgne aurait pourtant eu quelque honte à signer. Les juges n'y ont peut-être vu que du feu mais on ne leur demande pas, après tout, de se prononcer sur la vérité la plus intime d'un texte, vérité sur laquelle le critique doit, lui, rendre un jugement. Pour la seule juridiction dans laquelle je suis compétent, je déclare Yannick Haenel coupable d'usurper l'identité et les droits fondamentaux de l'écrivain qu'il n'est et probablement, fort heureusement, ne sera jamais.
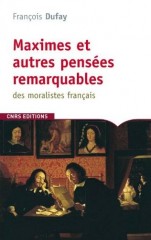 Chroniquant pour Valeurs actuelles le beau livre récemment réédité par les Éditions du CNRS de François Dufay (disparu l'année passée), Maximes et autres pensées remarquables des moralistes français, consacré aux maîtres du style que sont La Rochefoucauld, Vauvenargues ou le prince de Ligne, j'ai noté cette maxime de La Bruyère, bien évidemment extraite des Caractères que Yannick Haenel, avant d'écrire son prochain ouvrage, serait bien inspiré de méditer : «Il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs et subalternes, qui ne semblent être faits que pour le recueil, le registre, ou le magasin de toutes les productions des autres génies : ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs; ils ne pensent point, ils disent ce que les auteurs ont pensé; et comme le choix des pensées est invention, ils l'ont mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses, que d'excellentes choses; ils n'ont rien d'original et qui soit à eux; ils ne savent que ce qu'ils ont appris, et ils n'apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer, une science aride, dénuée d'agrément et d'utilité, qui ne tombe point dans la conversation, qui est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n'a point cours : on est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les Grands et le vulgaire confondent avec les savants, et que les sages renvoient au pédantisme.»
Chroniquant pour Valeurs actuelles le beau livre récemment réédité par les Éditions du CNRS de François Dufay (disparu l'année passée), Maximes et autres pensées remarquables des moralistes français, consacré aux maîtres du style que sont La Rochefoucauld, Vauvenargues ou le prince de Ligne, j'ai noté cette maxime de La Bruyère, bien évidemment extraite des Caractères que Yannick Haenel, avant d'écrire son prochain ouvrage, serait bien inspiré de méditer : «Il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs et subalternes, qui ne semblent être faits que pour le recueil, le registre, ou le magasin de toutes les productions des autres génies : ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs; ils ne pensent point, ils disent ce que les auteurs ont pensé; et comme le choix des pensées est invention, ils l'ont mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses, que d'excellentes choses; ils n'ont rien d'original et qui soit à eux; ils ne savent que ce qu'ils ont appris, et ils n'apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer, une science aride, dénuée d'agrément et d'utilité, qui ne tombe point dans la conversation, qui est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n'a point cours : on est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les Grands et le vulgaire confondent avec les savants, et que les sages renvoient au pédantisme.»Notes
(1) Deux passages, toutefois, évoquent l'étrangeté du monde entourant l'auteur et, en conséquence, la difficulté de le décrire. Le premier extrait rapproche la vision des cadavres de celle des corps utilisés dans le cinéma pornographique : «Même quand l’image était claire et nette, quelque chose n’était pas clair du tout, quelque chose de réprimé qui censurait les images et retenait les informations essentielles. Cela justifiait peut-être ma fascination en me permettant de regarder autant que je voulais; je n’avais pas encore de mots pour ça mais maintenant je me souviens de ma honte à regarder mes premiers pornos, toute la porno du monde», in Michael Herr, Putain de mort [Dispatches, 1968]] (traduction de Pierre Alien, Albin Michel [1980], 2010), pp. 28-9. Le second, lui, critique le langage journalistique opacifiant le monde : «Toutes les conférences de presse, à tous les niveaux, en venaient à ressembler à un catalogue de pièces détachées où le langage était un produit de beauté fait pour enlaidir. Comme presque toute la prose journalistique de cette guerre s’exprimait dans ce langage ou prenait le point de vue impliqué dans ce langage, il était impossible de savoir à quoi ressemblait le Vietnam en lisant la plupart des articles de journaux – aussi impossible que de sentir son odeur», ibid., p. 103.
(2) «Tous, photographes d'agence et grands reporters des stations TV ou radio et types spéciaux comme moi, nous faisions tous la même grimace, car nous savions tous que derrière chaque page imprimée sur le Vietnam il y avait une tête de mort qui riait, sanglante, qu'elle se cachait dans les journaux et les magazines, qu'elle restait collée la nuit à l'écran de la télé plusieurs heures après qu'elle fût éteinte, une image persistante qui voulait seulement vous dire enfin ce qui n'avait pu être dit», p. 224.
(3) L'une d'elle, transposée au détail près à l'écran, est même devenue une des scènes du film de Francis Ford Coppola (cf. p. 148 de notre livre).


























































 Imprimer
Imprimer