« Le spinozisme eudémoniste de Robert Misrahi, par Francis Moury | Page d'accueil | Raphaël Dargent et Sarah Vajda sur La Critique meurt jeune »
16/07/2006
Villa Vortex de Maurice G. Dantec

Voici, de nouveau publiée avec ses quelques lignes de présentation, ma critique consacrée à Villa Vortex de Maurice G. Dantec, initialement parue dans La Revue des deux Mondes dirigée par Michel Crépu. Je n'en reproduis d'ailleurs que les premiers paragraphes, de plus dépouillés de leurs notes, ce texte ayant été recueilli dans La Critique meurt jeune, ainsi que mon long entretien avec le romancier et ma série de textes sur Cosmos Incorporated, dont je redonnerai sûrement ici quelques extraits, histoire d'annoncer à ma façon la parution de Grande Jonction.
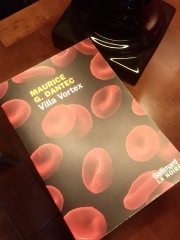 Il y aurait ici des pages à écrire sur la crétinerie des pseudo-critiques professionnels qui, sur Villa Vortex, le roman du polémique Dantec, n'ont rien su dire ou si peu que cela en devient pathétiquement drôle, par exemple sous la truelle d'une certaine Sabrina Champenois pour Libération. Passons. Qu'il est donc facile de critiquer la longueur (réelle) de ce roman pléthorique, gargantuesque et qui, c'est vrai, s'embourbe quelque peu dans sa dernière partie, sorte de polar mystico-futuriste qui joue avec la technique de l'enchâssement chère à Ian Watson et bien connue des lecteurs de Philip. K. Dick. À ce titre, on ne peut que souligner que Dantec est un lecteur averti, non seulement et selon toute apparence d'Ubik (voir la thématique du personnage mort qui contamine pourtant l'espace des vivants), mais aussi du Maître du Haut Château. Et de combien d'autres puisque Dantec, à la différence de ceux qui le vouent aux gémonies sans même l'avoir lu ou, ce qui est pire, mal lu, est un immense lecteur. Reste que, hormis L'Affaire Zannini de Marc-Édouard Nabe, je ne vois guère de livre récent comparable à Villa Vortex ni même de romanciers français qui, par leurs intentions et les moyens dont ils disposent, puissent aisément se comparer à ces deux... Si, il y a tout de même Houellebecq... En fait, au-delà des définitions simplistes (enquête policière et futuriste pour l'un, vrai-faux journal métaphysico-burlesque pour l'autre), Villa Vortex tout comme le livre de Nabe peuvent et doivent se lire, avant tout, comme une quête du vrai langage, dépassant par leur ambition Babel 17 de Samuel Delany ou même L'Enchâssement de Watson, le premier imaginant une forme de langage devenu arme absolue, le second une langue poétique qui, désormais, (re-)deviendrait, par sa capacité à nous faire pénétrer dans l'Autre réalité, la sorcellerie évocatoire dont parlait Baudelaire...
Il y aurait ici des pages à écrire sur la crétinerie des pseudo-critiques professionnels qui, sur Villa Vortex, le roman du polémique Dantec, n'ont rien su dire ou si peu que cela en devient pathétiquement drôle, par exemple sous la truelle d'une certaine Sabrina Champenois pour Libération. Passons. Qu'il est donc facile de critiquer la longueur (réelle) de ce roman pléthorique, gargantuesque et qui, c'est vrai, s'embourbe quelque peu dans sa dernière partie, sorte de polar mystico-futuriste qui joue avec la technique de l'enchâssement chère à Ian Watson et bien connue des lecteurs de Philip. K. Dick. À ce titre, on ne peut que souligner que Dantec est un lecteur averti, non seulement et selon toute apparence d'Ubik (voir la thématique du personnage mort qui contamine pourtant l'espace des vivants), mais aussi du Maître du Haut Château. Et de combien d'autres puisque Dantec, à la différence de ceux qui le vouent aux gémonies sans même l'avoir lu ou, ce qui est pire, mal lu, est un immense lecteur. Reste que, hormis L'Affaire Zannini de Marc-Édouard Nabe, je ne vois guère de livre récent comparable à Villa Vortex ni même de romanciers français qui, par leurs intentions et les moyens dont ils disposent, puissent aisément se comparer à ces deux... Si, il y a tout de même Houellebecq... En fait, au-delà des définitions simplistes (enquête policière et futuriste pour l'un, vrai-faux journal métaphysico-burlesque pour l'autre), Villa Vortex tout comme le livre de Nabe peuvent et doivent se lire, avant tout, comme une quête du vrai langage, dépassant par leur ambition Babel 17 de Samuel Delany ou même L'Enchâssement de Watson, le premier imaginant une forme de langage devenu arme absolue, le second une langue poétique qui, désormais, (re-)deviendrait, par sa capacité à nous faire pénétrer dans l'Autre réalité, la sorcellerie évocatoire dont parlait Baudelaire...Il paraît aussi évident d'affirmer que cette dimension (cachée, voire ésotérique...) de Villa Vortex est passée presque totalement inaperçue des critiques, je l'ai dit, qui certes n'ont jamais songé à rappeler les références pourtant évidentes de Dantec (et de Nabe) : Barbey, Bloy, Hello, qui tous, à divers degrés, s'affligèrent de la pauvreté du véhicule littéraire dont ils se servaient, tout en le conduisant vers des terres jusqu'alors inexplorées ... Oui, décidément, le cadavre de la littérature française, qui il y a peu bougeait encore selon certains optimistes, paraît à présent parfaitement mort... Reste que seuls Nabe et Dantec, même si Villa Vortex est critiquable sur bien des points (puisque par exemple la seconde partie de ce roman n'est qu'assez difficilement conciliable avec la première, remarquable), paraissent encore capables de lui insuffler quelque vie... Qui d'autre ? Florian Zeller ? La triade acéphalique Millet/Angot/Nothomb ? Oui, je sais ! : Nabe ou même Richard Millet, qui s'imagine être le dernier écrivain de langue française, alors qu'il y a Sarah Vajda, Jean Védrines, Guy Dupré, combien d'autres encore... Je corrige d'ailleurs ce que je viens d'écrire un peu trop rapidement, en retirant Nabe de cette liste fort réduite, l'hystérique nain pseudo-bloyen s'étant depuis quelques mois durablement embourbé dans les sables irakiens avec son affligeant Printemps de feu... et je ne parle pas de sa revue à tirage limité (qu'en est-il de son lectorat réel ?), La Vérité, aussi aguicheuse qu'une putain centenaire.
«Les hommes craignent la vérité parce qu’une seule étincelle de vérité formulée et vécue en fait éclore d’autres […].»
Wilhelm Reich, Le Meurtre du Christ (Éditions Champ libre, 1971).
Villa Vortex de Maurice G. Dantec, qui est le premier tome d’une trilogie intitulée Liber Mundi, a sans doute fait parler les critiques. Parler et non pas écrire. Dantec n’a d’ailleurs guère dû s’étonner des quelques réactions provoquées par son livre, lui qui remarquait fort justement, dans son Théâtre des opérations, que «quand l’horizon de la littérature se restreint aux moi des auteurs, c’est qu’elle se trouve déjà allongée dans le caveau de famille». Nul doute sur ce point : la littérature française contemporaine n’est plus même un cadavre qui mime la vie, se souvient qu’il a vécu, bouge encore et, parfois, parle, d’une parole échangeable, soumise au plus offrant, monnayable comme l’est une marchandise, c’est-à-dire une catin. Bref, nous ne cessons d’entendre les râles d’alcôve d’une «parole putanisée», selon la trouvaille de Michel Waldberg qui n’évoque cependant pas la prochaine étape, à vrai dire déjà réalisée, celle d’une parole cette fois totalement aseptisée, clonée, donc pornographique dans sa répétition mécanique ou angotique, parole neuve, novlangue que plus aucun lien ne rattache désormais à la vie. La littérature française n’est donc plus une charogne mais un fantôme, mieux un simulacre qui s’est totalement abstrait du réel, qui, tel l’idiot, s’est coupé de lui, sans même la ressource de convoquer, comme le roman de Faulkner, le bruit et la fureur. Je ne surprendrai que les mauvais lecteurs ou les critiques qui ne font rien d’autre que s’entregloser en affirmant dès lors que l’intention la moins commentée du livre de Dantec est d’avoir justement voulu sauver l’écriture du naufrage. Aussi peu modestement qu’il convient à tout réel écrivain, le but poursuivi par l’auteur est ainsi péremptoirement posé : «faire (sur)vivre la littérature». La déshumanisation incriminée du langage est une des conséquences de la réification totale de l’homme et du monde selon Dantec : «Il ne fallait plus s’étonner si le langage lui-même devenait ciment, dès lors que les artistes choisissaient d’œuvrer avec les bétonneurs […] (VV, 103). Il s’agira dès lors, pour le flic Kernal, principal personnage de Villa Vortex, comme pour le romancier lui-même, de se lancer à la poursuite du langage édénique qui, selon Walter Benjamin, jouissait d’un réel pouvoir d’évocation, était capable d’appeler les choses et les êtres à leur existence, en les nommant. Avant que le langage des hommes ne soit rendu impuissant par la lèpre de ce que Benjamin appelle la «surdénommination», la parole était, vraiment, la «sorcellerie évocatoire» du poète. Mais, dans Villa Vortex qui évoque la phase terminale du cancer qui ronge la France et l’Europe, donc leur langage creux, les mots sont bien évidemment totalement séparés des choses, incapables qu’ils sont d’évoquer la moindre réelle présence. Totalement séparés ? Pour le mystérieux tueur en série poursuivi par Kernal, les mots et les choses ne font qu’un, il n’y a aucune coupure entre le désir et l’action, aucune séparation entre la matière même du mot et la chose, c’est-à-dire le corps torturé. Ainsi, les cadavres mutilés des jeunes filles que découvre Kernal, par un monstrueux procédé informatique inventé par le tueur, sont-ils capables de s’animer et, même, de parler ou plutôt de hurler, postmortem, l’enfer de leur supplice. La parole réelle, celle des pauvres torturées, on le voit, vient d’une région dans laquelle il faudra pour Kernal ne pas craindre de s’aventurer. D’emblée encore, l’acte premier par excellence, le Fiat divin, est ici retourné et parodié par les hurlements des victimes qui, en somme, appellent à la vie, mais à une vie elle-même ridicule et grotesque, leur propre cadavre.
Dès lors, le vortex évoqué par Dantec est moins celui qui d’ici peu aura avalé la Ville moderne que le maelström tapi au sein même de son livre. L’auteur de Villa Vortex, comme le narrateur du conte de Poe, ne peut-il donc s’adresser à ses lecteurs qu’au moyen d’une ridicule bouteille jetée à la mer à laquelle il aura confié ses dernières paroles avant de sombrer dans le gouffre hurlant ? Fort bien car, c’est une chance inespérée, dans le danger croît aussi ce qui sauve puisque ce maelström est tout simplement la Parole, originelle, séminale, aujourd’hui rongée par la lèpre des «discours publicitaires et des ritournelles citoyennes» (VV, 64) mais qui, selon nombre d’auteurs (comme Léon Bloy, fort apprécié par Dantec, ou Ernest Hello, que cite Mard-Édouard Nabe dans Alain Zannini) regroupés par George Steiner sous l’appellation de «logocrates», renferme encore, faiblement, une lueur, rougeoyante dans le foyer de l’étymon, qu’il s’agira donc de ranimer pour espérer en faire un feu. Pour ces logocrates comme pour Dantec, le langage est donc «le miroir de l’Être», selon l’expression de Georges Bernanos. Se servir des mots pour ne strictement rien dire, c’est donc atteindre l’Être et le prostituer. Inversement, et là se trouve bien l’immense difficulté, peut-être même l’échec final du romancier, plonger dans la Parole n’est certainement pas une affaire vite expédiée de cicérone étourdi. Dans Monsieur Ouine, autre roman crépusculaire chantant la nuit du monde, autre œuvre à l’écriture lacunaire, tronquée, elliptique et énigmatique, autre roman policier dévoyé (mais avec un crime non élucidé et sans meurtrier) qui est une plongée dans le chaos et le Mal à nulle autre pareille, unique je crois dans la littérature occidentale, c’est le néant dans lequel va tomber le personnage éponyme, ancien professeur de langues, qui constitue paradoxalement le foyer de l’écriture, la matrice originelle depuis laquelle la parole bernanosienne s’est élancée, pour trouer de ses innombrables efforts l’obscurité des mots qui ne veulent plus rien dire, qui, pipés et moqués, ne servent plus qu’à grasseyer la ritournelle aigre de l’Arrière. Dès lors, l’écrivain, selon l’image mille fois jaunie mais néanmoins parfaitement juste, doit réellement ne pas craindre de pénétrer dans le royaume duquel Orphée puis Dante, pour nous délivrer leurs chants, sont revenus.
Cette plongée est un éveil. Celui auquel nous convie Dantec risque bien, à tout le moins, de nous surprendre, de nous prendre au dépourvu comme si nous étions conviés à ouvrir nos yeux sur l’espace noir de l’horreur, sur ce que nous ne faisions que soupçonner et qui à présent nous est indiqué sans détour : la vraie vie est la mort et, tout autant, la parole partout diffusée, la parole littéraire (donc, de nos jours, entièrement médiatisée) et intellectuelle de nos élites n’est rien d’autre qu’un simulacre, la mort et la putréfaction se donnant l’apparence de la vie.
Je suis vivant et vous êtes mort
Qu’est-ce que Maurice G. Dantec a voulu nous dire avec Villa Vortex ? En grand lecteur de l’œuvre de Philip K. Dick, il n’est guère difficile de comprendre que Dantec a désiré analyser et illustrer avec son roman cette consternante banalité : nous sommes morts et c’est moi qui suis vivant. Moi, Kernal, le personnage principal du livre ? Non, puisque ce flic est mort avant même que d’avoir commencé sa narration. Marc Naudiet alors, le mystérieux tueur en série que Kernal ne parviendra jamais à capturer ? Non car le meurtrier est décédé d’un cancer des os alors que le policier ne cessera d’amasser des preuves de sa culpabilité, dans une opiniâtreté un peu folle qui le rapproche du policier du roman de Dürennmatt intitulé La Promesse. Les cadavres des pauvres suppliciées, qui sont encore capables de parler par un montage informatique astucieux du tueur ? Non, à l’évidence. Qui donc alors ? Moi, Maurice G. Dantec, l’auteur de ce livre intitulé Villa Vortex ? Non car Dantec ne cherche rien tant, frénétiquement, que sa propre disparition, transpercé par la corne de taureau de l’écriture qui exige que l’on prenne tous les risques, comme l’illustre également ce roman de la transformation ou plutôt résurrection qu’est Alain Zannini. Moi enfin, le livre, qui ne suis pourtant rien de plus qu’un livre clos, achevé, un livre fractal donc, une bribe, imparfaite et limitée dans ses béances mêmes et ses écritures alternées, que Dantec oppose à la cohérence insurpassable de la Bible (TdO, p. 524), du Livre, de l’Infini ? Oui, c’est bien moi, Villa Vortex, livre borné et pourtant, sans être de sable comme celui de Borges, infini, qui suis vivant. C’est là le second paradoxe du roman de Dantec, auteur qui, après tout, n’est qu’un prête-nom parmi tant d’autres, auteur qui, comme Paul Gadenne dans son énigmatique Invitation chez les Stirl, pourrait bien prétendre qu’il n’est absolument rien de vivant, si, justement, ce prénom, cette initiale et ce nom, Maurice G. Dantec, ne rappelaient aux lecteurs l’existence d’un auteur que les imbéciles déclarent sulfureux alors qu’il n’est rien de moins qu’absent, bouche d’ombre de la fin de partie chère à Beckett qui, comme le personnage du tueur en série, ne peut s’empêcher de disparaître, de digérer sa propre œuvre afin de renaître à une exigence plus haute, à une vérité que la littérature ne fait qu’entrevoir. Car l’écriture de Dantec est une théurgie, qui rien de moins que métaphoriquement exige la mort de l’auteur, son effacement. Les mots qui suivent valent donc pleinement pour le romancier : «à mesure que Kernal est attiré vers le bas […] son esprit est aspiré par le haut, vers les limites de la connaissance pure».
Un rapprochement peut ici être esquissé entre le flic Kernal, qui jamais n’hésite à nous affirmer sa volonté de rejoindre la nuit, et le démoniaque F. Vidal Olmos, personnage du second roman d’Ernesto Sábato, Héros et Tombes, qui traque sans relâche la mystérieuse Secte des aveugles, enfouie dans les profondeurs souterraines où se perdra d’ailleurs Olmos, non sans avoir, peut-être, touché à la Vérité maléfique que cache ce monde inverti. Entrevoir cette Vérité ultime, pour Olmos comme pour Kernal, ce sera mourir, selon les principes mêmes de toute initiation. Il y a plus car, pour l’auteur, parler depuis le royaume de la mort c’est placer son œuvre tout entière sous un éclairage inhabituel : le soleil noir d’Auschwitz. À ces mots, j’entends rire les imbéciles. Ainsi et contre le commandement (mille et mille fois ressassé) édicté par Adorno, Dantec n’hésite pas à plonger son regard dans ce que nous pourrions appeler, après Armand Robin, un véritable «camp de concentration verbal» et, avec le romancier de Babylon Blues, un «trou noir>». Écoutons l’auteur affirmer qu’il «ne s’agit même pas, en effet, de vouloir à tout prix décrire l’expérience concentrationnaire nazie, mais de savoir l’inscrire dans notre processus de création, de savoir indiquer dans nos livres que nous sommes bien ceux d’Après […]» (TdO, 345). Nos lecteurs consciencieux auront remarqué que, par cette problématique, par celle qui, de livre en livre, lui fait mêler réflexions sur la politique et sur la révolution biologique en cours, à dire vrai déjà intimement présente dans nos vies, l’auteur de Villa Vortex offre une saisissante illustration de certaines des thèses de Giorgio Agamben qui, à la suite des travaux de Michel Foucault, affirme que l’expérience concentrationnaire est devenue le véritable nomos de la politique moderne ou plutôt de la biopolitique puisque le corps humain, désormais, est tout entier livré à la technique, devenu champ d’expérimentation et de réification infinies pour la science. À ce titre, la description que Dantec nous donne de la ville moderne ressemble à s’y méprendre à celle du camp de concentration : «le biotope paradoxalement sans vie de cette zone industrielle est désormais le tabernacle du sacrifice, le lieu sacré recelant en son centre un être sans identité anéanti par la décomposition terminale de l’homme anonyme des mégapoles» (VV, 37). Je n’éviterai pas de redoubler la banalité du discours sur la Shoah en répétant que cette expérience concentrationnaire est proprement intransmissible, incommunicable mais que Villa Vortex, sans en parler directement, est pourtant un livre né d’Auschwitz. Nous pourrions dès lors affirmer que l’expérience concentrationnaire est devenue, au moins depuis Paul Celan, le véritable nomos de toute vraie littérature, qui doit s’écrire, plus que jamais, devant le bourreau, fût-il parfaitement invisible comme dans l’une des paraboles d’Imre Kertész, Le Chercheur de traces. Sur cette route âpre et tortueuse, où les crachats des crétin ne manquent et ne manqueront pas de fuser, Dantec n’est pas seul : à sa façon aussi, rien de moins qu’intuitive et zébrée de noires illuminations, George Steiner répète à chacun de ses livres qu’Auschwitz est le creuset bestial où la langue elle aussi, comme un immense corps vivant martyrisé, a plongé avec des millions de victimes réduites en cendres, sans doute parce que, dans un parallèle qui n’a pas manqué d’offusquer les petites âmes, le Verbe a sombré dans le gouffre du Golgotha.
Imre Kertész une fois de plus, dans Un Autre, établira à son tour une scandaleuse proximité entre l’horreur absolue de la Crucifixion et celle de la Shoah. Villa Vortex, en voulant libérer la langue de sa mécanique et confondante banalité – cette même banalité du Mal analysée par Hannah Arendt qui scandalisa – désire sans doute éviter, moins inconsciemment qu’il n’y paraît, que le langage puisse être réduit, une nouvelle fois, à l’immense mensonge que façonna expertement la propagande nazie et, de nos jours mais de façon parfaitement homéopathique, nos médias.
Liber mundi
Avec Villa Vortex, Dantec entreprend la quête véritable de tout écrivain réel, quête qui était celle du narrateur du conte de Borges, quête qui est celle, fébrile et mallarméenne au possible, du Livre : «Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu'à nous : celle de l'Homme du Livre. Sur quelque étagère de quelque hexagone, raisonnait-on, il doit exister un livre qui est la clef et le résumé parfait de tous les autres : il y a un bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un dieu».
Qui, dans le roman de Dantec, tient le rôle de ce bibliothécaire semblable à un dieu ? Nitzos ? Kernal lui-même ou bien son initiateur, Wolfmann, cet animal de l’ombre, ce stalker diabolique qui ne se déplace que dans la Zone de l’entre-deux et du secret, à pas de loups ? À moins qu’il ne s’agisse encore de ce mystérieux Bibliogôn, matrice de toute écriture possible qui lancera les personnages du Quatrième Monde à l’assaut de la forteresse lilliputienne des maîtres du langage perverti ? Remarquons que Villa Vortex illustre par l’exemple son propre miroitement (au sens premier de ce terme), moins par les nombreuses méditations sur les théories cabalistiques concernant le langage qui en ponctuent la narration, moins encore par les différents types d’écriture ou même de documents enchâssés dans la trame des aventures de Kernal que par la mise en abyme qui caractérise sa construction. Je veux parler de cet autre livre que contient le roman de Dantec, sorte de créature monstrueuse qui ne cessera jamais de diffuser son lent poison dans le corps-gigogne qu’il creusera et videra pour s’y installer. Ce livre au milieu du livre (physiquement d’abord puisque le chapitre du Manuscrit trouvé à Sarajevo se situe peu ou prou à mi-parcours de Villa Vortex) est relié au Monde-de-la-Mort par le filet de la parole suintant depuis la Ville-de-la-Mort, Sarajevo. Nitzos, mystérieusement lié à Kernal, imagine une œuvre qui conterait l’histoire d’un patient enquêteur traquant un tueur en série, histoire justement racontée par Dantec, histoire justement dédoublée par la Matrice du Quatrième Monde. Or, lorsque Kernal lit le manuscrit où Nitzos expose ce que sera l’idée de son méta-roman (cf. VV, 385), ce dernier est déjà mort et le premier jouit d’un statut indéfinissable. Il est vivant ET mort, comme le Valdemar d’Edgar Poe. Nous avons donc là de réelles confessions d’outre-tombe. Ce n’est pas tout puisque, progressivement, Kernal lui-même comprend qu’il n’est que l’invention de Nitzos ou l’une de ses «transmigrations» et que, en fin de compte, c’est le manuscrit de ce personnage qui détient la vérité, pas même Nitzos. Tout le reste est-il faux ? Tout le reste, c’est-à-dire l’enquête, puis les enquêtes de Kernal, embourbé dans un mystérieux complot entre les services de sécurité algériens et les services secrets français ? Non, Dantec est plus subtil. Sans doute se souvient-il aussi de sa lecture du Maître du Haut Château de Philip K. Dick, dans lequel l’oracle millénaire chinois, le Yi-King, affirme que l’univers dans lequel se débattent les personnages, cette uchronie qui a vu le triomphe des puissances coalisées de l’Italie fasciste, de l’Allemagne nazie et du Japon impérialiste, n’est pas totalement faux : tout simplement, ce monde n’est pas le bon. Nous sommes ici dans le règne spéculaire du simulacre, qui entretient avec le monde original un rapport de décalage ou de diffraction, comme si les personnages qui sont emprisonnés dans l’univers-reflet ne pouvaient voir notre univers qu’au «travers d’un miroir et comme en énigme», selon la parole fulgurante de l’apôtre, comme si aucun indice ne pouvait nous garantir que l’univers dans lequel nous nous mouvons est plus valable qu’un autre. L’écriture de Dantec se déploie selon une double hélice, paradoxale plutôt que contradictoire : elle signifie la tromperie et, dans le même mouvement, en ne cessant de s’enrouler sur elle-même comme un serpent, en décrivant ces «gyres» dont parlait Yeats, elle se condamne à demeurer prisonnière d’une sorte d’in pace démoniaque. Car, de la spirale décrite par le vortex qui en fait est un gouffre, l’écriture de Dantec ne peut s’échapper seule.
La voie ténébreuse de la Vérité
Il y aurait beaucoup de choses à écrire sur la vision du Mal que nous propose cette œuvre complexe, par exemple en rapprochant son traitement romanesque des différentes techniques picturales qui, selon Enrico Castelli, permettent au peintre d’évoquer la manifestation démoniaque...
La suite de cet article se trouve dans ma Critique meurt jeune.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, science-fiction |  |
|  Imprimer
Imprimer
























































