« Rimbaud, Bernanos et Frank Herbert | Page d'accueil | Lettre à un ami français, Daniel Cohen »
18/05/2004
Dominique de Roux, immédiatement !

Crédits photographiques : Hrvoje Polan (AFP/Getty Images).
Très bel article de Laurent Schang dans les actualités de Cancer ! concernant Dominique de Roux, foisonnant et subtil écrivain consciencieusement embastillé par les gardes-chiourmes de la Rive gauche. J’avais lu, il y a longtemps, L’Ouverture de la chasse publié par L’Âge d’Homme en 1968 où j’avais noté ce passage qui m’avait troublé : «Dans un univers consubstantiellement asservi au péché de la déformation — le mot péché ici n'a qu'une signification allégorique — la grâce ne saurait plus qu'affermir le péché, et seule une sorte de sur-péché risquerait encore de tout remettre en cause. Il entraînerait à l'autoconsommation du péché, en accélérerait les combustions, en atténuerait les langueurs».
Dans ces lignes qui mélangent attente de l’eschaton et révélation de la réalité, le romancier se montre le direct continuateur de Bloy à l’évidence mais aussi de Bernanos : seul peut encore nous sauver un cataclysme qui par son ampleur balaiera la boursouflure du monde contemporain, position éminemment apocalyptique qui ne s’accorde que bien rarement (pour ne pas dire : jamais) avec la politique de nains telle que la conçoivent la majorité des dirigeants occidentaux. Si ce devait être le cas, il faudrait imaginer comme l’a fait Walter Benjamin dans ses dernières méditations sur l’Histoire un bouleversement non seulement politique mais à l’évidence eschatologique qui, à dire vrai et dans un passé fort récent, a bien failli tout emporter avec la rage suicidaire d’Hitler. Mais cela encore n’est rien, les millions de victimes de la Seconde Guerre mondiale sont comme un fétu lorsque l’on songe au véritable djihad que lancera sur la terre Celui qui, dans l’esprit enfiévré de Bloy, n’était pourtant que l’annonciateur du Christ de la fin des temps. Frank Herbert a compris cela dans son cycle arrakien, qui mentionne plusieurs razzias d’échelle cosmique, dont celle qu’il appelle le djihad butlérien: l’humanité est contrainte de se régénérer par la guerre, position qui fera jauni d’un coup l’atoll placide des bien-pensants, position presque toujours illustrée par la littérature et le cinéma d’outre-Atlantique, très rarement par nos propres œuvres, plus préoccupées par le fait insigne de décortiquer l’appareil sexuel de nos contemporains. Pourquoi ? La réponse la plus évidente mais aussi celle qu’il sera sans doute impossible d’expliquer à nos concitoyens déchristianisés, que dis-je, dédouanés de toute forme d’inquiétude spirituelle, consisterait à affirmer, banalement, que l’Amérique du Nord, pour le pire et le meilleur (et le meilleur qui naîtra par le pire, sentence hölderlinienne presque parfaite), est une nation apocalyptique, à l’image d’ailleurs de sa littérature dont à mon sens le génie visionnaire (au sens premier du terme) a une fois pour toutes été quintessencié par William Faulkner, d’ailleurs admiré par Dominique de Roux.
À propos de : Rémi Soulié, Les châteaux de glace de Dominique de Roux, Lausanne (L'Âge d'Homme, coll. Les Provinciales), 1999. Les pages entre parenthèses renvoient à l’édition indiquée.
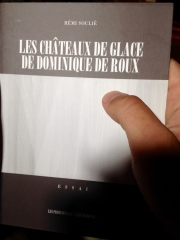 Acheter Les châteaux de glace de Dominique de Roux sur Amazon.
Acheter Les châteaux de glace de Dominique de Roux sur Amazon.Comme Boutang naguère et comme jadis Bloy dans son tonitruant Journal que Pierre Glaudes vient de rééditer (ces lignes furent écrites en 1999), Rémi Soulié a de ces emportements nourriciers dans son livre, le quatrième déjà de la collection dirigée par Olivier Véron. Après tout, cette violence est salutaire, car, comme l'auteur qu'il choisit de présenter l'a écrit, «il n'y a pas de littérature sans la fascination de la chose unique, sans le vertige d'une seule attention». Ce petit ouvrage aussi tranchant que l'arrête de glace (peinte par Gérard Breuil) qui orne sa couverture, est un livre pressé d'en finir comme il a commencé, la liberté des derniers lieux sauvages fréquentés par quelques barbares présidant aux résurrections tutélaires convoquées dans son incipit : «Je ne crois plus qu'au maquis, dit-il, aux cénacles et aux catacombes pour échapper à la bulle gloutonne de ce qu'il faut exactement appeler la chambre stérile du monde où s'affairent» ces «fanatiques de la nullité» dont parlait De Roux dans une lettre à Abellio (p. 16).
Sans doute Soulié a-t-il trouvé l'endroit propice aux méditations sauvages et au style qui éperonne, comme la sorcière, selon Michelet, qui ne pouvait naître que dans les landes recouvertes de ronces, d'où elle allait lancer sur le monde des sots à découvert ses philtres de destruction les plus puissants. De Roux écrit dans son Ouverture de la chasse que la «liberté, aujourd'hui est dévastation». J'ajouterai qu'elle ne peut être que cela, ruine. Ruine et errance, quête errante d'absolu, comme le combat mené par l'écrivain, selon Soulié, pour «la Dame Beauté», qui prendra «toutes les formes extrêmes, politiques, religieuses, physiques». «La laideur, ajoute l'auteur, ce n'est rien d'autre que la tiédeur» (p. 74), car la beauté, comme chacun le sait parfaitement ou devrait s'appliquer bien le savoir, étant toujours extrême comme la métaphysique, est de droite selon De Roux. Notez que je parle de la droite idéale, c'est-à-dire métaphysique, non pas de celle qui afflige notre patience, droite bien-pensante, veule, aguicheuse et stupide.
De Roux est extrême, sans doute, comme Rimbaud exposant son dérèglement systématique de tous les sens. Mais cet extrémisme est d'abord critique lancée contre la déchéance métaphysique dans laquelle l'Occident a sombré sous les yeux de quelques veilleurs. Ainsi l'auteur du Livre nègre eût pu faire sien, comme Rimbaud, pareil engagement de forcené du verbe, avant d'encalminer son étrave bleue dans la chaleur vacante, non pas, cette fois, celle du Harare (devenu avec Alain Borer le Saint-Tropez des touristes bigleux), mais celle de la tremblante image d'un Portugal mystique, à jamais refusé, jadis rêvé par le Père Viera dans ses superbes visions. L'un et l'autre de ces impeccables écrivains, Rimbaud et De Roux, ont oublié une de leurs jambes, restée prisonnière dans la gangrène de la tourbe européenne, cette infecte saumure paralysant les nerfs du poète, comme un dernier croc-en-jambe qu'aurait fait la médiocrité au voyant erratique, un coup bas assené dans le ventre de ce père sans descendance, qui a pourtant enfanté chacun des écrivains majeurs de notre siècle. Quant à celle de De Roux (écrivant justement dans ce livre païen qui fut l'un des premiers titres d'Une Saison en enfer !) : «L'Europe ne valait guère mieux soumise à la matière et au conformisme de la quantité; le génie rapetissé à l'intelligence pratique gouverné par le qu'en-dira-t-on. Payez le prix et les médias vous mettront dans la poche l'opinion publique qui, elle, croira toujours que cette vérité fabriquée, maîtresse de l'instant, est d'origine divine», ce membre remarquable qui fit de cet homme un flaireur, un découvreur (plus : un véritable nommeur, selon la définition qu'en donnait Nietzsche), un marcheur hors-pair s'aventurant à la rencontre de génies de l'écriture encore méconnus ou conspués à son époque, c'est bel et bien la bassesse rampante de la finance-spectacle qui a paralysé son formidable élan.
De sorte que, nous devions nous y attendre, ce ne sont pas les éructations du Dies Irae qui ont secoué le monde vain des hommes creux et qui ont emporté dans leur ire la protestation ivre de Dominique de Roux, mais l'espèce de consternante mollesse dans laquelle se prélassent les satrapes des fins d'empire, ces louvoiements de croupes où l'on devine la présence des âmes perverses : «Le monde a été conçu dans le feu, écrit ainsi superbement l'auteur de L'Harmonica-Zug, vient du feu et y retournera. Mais dans les sentiers du feu, une certaine décadence d'émeraude, symbole de la trahison vipérine du doute, de l'éternelle contestation du néant, détourne le feu de ses prolonges d'acier, vers les cloaques délicieux qui sont à la Jérusalem céleste de nos enfances rimbaldiennes, ce que sont aujourd'hui à Istamboul, les harems à poufiasses couvertes de pierreries creuses pour touristes aveugles»
«Mais dans les sentiers du feu»... Ce sont bien eux, et non pas les torves marécages de la «trahison vipérine du doute», les louches mastroquets où Sollers tient conférence devant son miroir à l'eau moussâtre et verdeuse, ce sont bien eux, ces derniers lieux de pudeur et de franchise réservés aux hommes de parole, ce sont bien ces chutes d'eau vive que la prose agitée de Rémi Soulié est rageuse de trouver pour en rejoindre l'éternel fracas et s'y consumer.


























































 Imprimer
Imprimer